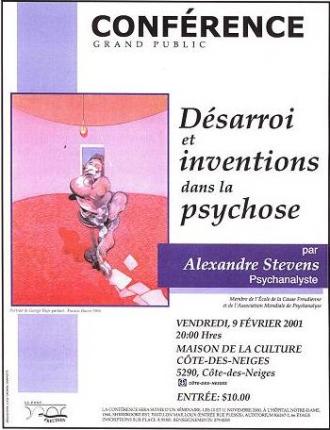
Oui, donc, désarroi et invention dans les psychoses, c'est ce dont je vais essayer de vous entretenir, d'une manière que j'essaierai très clinique. Au fond, ce titre " désarroi et inventions " situe, correspond à un binaire qui est assez classique dans la psychanalyse. Le désarroi situe ce qui fait irruption de l'extérieur, ce qui déstabilise le sujet et l'invention, ou les inventions, nous évoquent ce que le sujet invente ou construit pour répondre à cette irruption.
Je voudrais insister là-dessus au point de départ de mon intervention. Je dirais que c'est une position éthique de la psychanalyse, une position de choix éthique de la psychanalyse de ne pas considérer le sujet psychotique comme présentant un déficit, par exemple un déficit du rapport à la réalité. Encore que certains psychanalystes post-freudiens, comme les nomme Lacan… Je pense, par exemple, à Margaret Mahler, qui a traité d'enfants autistes et qui a écrit, par ailleurs, un ouvrage extrêmement intéressant, cliniquement, sur la psychose. De formation annafreudienne, Margaret Mahler considère que les enfants psychotiques présentent un déficit de compréhension logique des phénomènes en cause. Elle a d'ailleurs là-dessus un certain nombre d'exemples. Je vous en mentionnerai un, simplement : c'est un enfant qui, à chaque fois qu'il est dans son bureau - c'est un enfant psychotique à la limite de l'autisme et de la schizophrénie - semble extrêmement inquiet, à la fin de la séance, quand la sonnette annonce la séance suivante, quand la sonnerie retentit. Alors, comme elle a l'idée qu'il s'agit d'un déficit de compréhension, elle essaie de lui expliquer et puis elle lui explique, et ça ne le rassure pas tout à fait. Alors, elle lui explique concrètement ; elle lui dit : " On va voir comment ça fonctionne ", puisque son idée est celle d'un déficit de compréhension logique. " On va voir comment ça fonctionne ", et elle l'amène dans le couloir, elle l'amène à la sonnette en bas : " On pousse, tu vois, ça sonne. Quand on pousse ici, c'est le suivant " ; et elle le fait remonter, elle sonne elle-même en bas, on peut imaginer le petit scénario qu'elle produit là. Au moment où la sonnette retentit pour la séance suivante, l'enfant présente à nouveau la même inquiétude. Elle lui dit : " Mais pourquoi, puisque tu as compris ? " (parce qu'il lui avait dit : " Oui, j'ai très bien compris "). Il lui dit : " Mais cette fois-ci, la sonnette savait que j'attendais qu'elle allait sonner ". Il répond bien que ce n'est pas d'un déficit de compréhension qu'il s'agit.
Donc, je pense que c'est une position éthique de considérer le sujet psychotique non pas situé à partir d'un déficit de compréhension ou d'un déficit quelconque, mais plutôt comme celui qui invente sa réponse à un certain mode du réel qu'il a atteint, qui invente sa réponse - qu'elle soit de délire, son symptôme, ou production plus éminente ou plus modeste dont je ferai état en quelques exemples tout à l'heure - à l'irruption de ce réel. Quelque chose lui est tombé dessus, une rupture dans l'ordre du discours, et à cela, il cherche une réponse. C'est ce que je vais mettre en valeur, donc, par ce couple : désarroi et invention.
Je dis : c'est un couple classique de la psychanalyse, c'est le couple freudien " trauma et symptôme " qui, lui, est un couple qui plutôt s'articule à la névrose. Cela reste cependant ce couple d'un sujet qui, confronté à un certain réel, le trauma, y réagit par la construction d'un certain symptôme.
C'est le couple lacanien, propre à la psychose : retour du signifiant dans le réel - j'essaierai de préciser ça un peu tout à l'heure - et réponse du sujet. Lacan montre bien comment le signifiant forclos, le signifiant retranché de l'ordre symbolique... Je pense qu'Antonio Di Ciaccia avait abordé cette question. C'est ce qui fait qu'au fond, la grande distinction entre névrose et psychose tourne autour de cette question du refoulement, autour de la manière dont le signifiant est refoulé. Dans la névrose, il est refoulé, mais dans le mouvement même où il est refoulé, il est refoulé tout en restant dans l'ordre symbolique, c'est-à-dire dans l'ordre du langage. C'est ce que Freud appelle le retour du refoulé. Le refoulement, en même temps, présente un retour du refoulé sous la forme symptomatique de la persistance de ce qui est refoulé, transformé. Dans la psychose, au contraire, le signifiant qui est rejeté n'est pas maintenu dans le symbolique sous la forme d'un retour et, par conséquent, revient au sujet comme surgissant de l'extérieur, sous la forme d'une voix par exemple.
C'est encore le couple logique aristotélicien du contingent et du possible, donc de l'irruption d'une rencontre contingente, occasionnelle, et du possible de la réponse du sujet à cet inattendu. Le contingent - comme l'appelle Aristote - c'est-à-dire l'inattendu de la rencontre, l'occasion de la rencontre, de la surprise ; c'est un terme qui situe par ailleurs un accent majeur de la cure analytique. On pourrait dire que le sujet, tout sujet cherche spontanément l'homéostase. Comme dit Lacan, il est heureux. Il cherche le plaisir qui satisfait une certaine homéostase, sans déranger. Le sujet est heureux autant, d'ailleurs, dit Lacan, que le signifiant est bête, c'est-à-dire fonctionne dans l'automaton. Mais le sujet rencontre, à l'occasion, des surprises et, au fond, la position de l'analyste ne consiste pas à aider le sujet à retrouver son homéostase, mais plutôt à le rendre prêt à la surprise, à le rendre prêt à saisir la surprise et à y répondre.
Alors ce mouvement de la psychanalyse, ce mouvement même de la cure analytique est à nuancer, sans doute, dans la psychose puisque dans la psychose, il y a parfois lieu, au contraire, d'aider le sujet à tenir un certain type d'irruption, de surprise à l'écart, ce qui peut le faire déclencher, ce qui peut déstabiliser son monde.
Je prendrais un petit exemple clinique que je prélève d'une présentation de malade que j'ai entendue, présentation faite par mon collègue Éric Laurent, il y a déjà un certain nombre d'années, à l'Hôpital Sainte-Anne à Paris. Il s'agissait d'une jeune dame d'origine algérienne, en France depuis un an environ, venue rejoindre son père, qui était le seul membre de la famille à avoir émigré, dans un premier temps, et qui la faisait venir pour qu'elle puisse faire des études en France. Et puis, pendant le temps où elle était en France, elle est retournée à un moment dans sa famille, en Algérie. Elle est revenue en France, et puis, elle ne s'est pas sentie tout à fait bien et puis, surtout, elle fait des études du côté de la psychologie et on lui dit que ça serait pas mal qu'elle participe à un groupe de parole, à un psychogroupe, de je ne sais plus exactement quel type ; et elle va donc à un groupe de ce type-là, et elle parle avec les autres. Elle explique sa famille, elle parle beaucoup de son père, de sa famille qui reste en Algérie, etc., et au bout de deux jours, l'animateur du groupe lui dit : " C'est très bien tout ça, mais il serait temps que tu essaies de nous dire aussi quelque chose de toi ; qui es-tu, toi ? " Et cette fille reste à ne pas pouvoir en dire un mot mais, quelques minutes plus tard, elle sort avec le sentiment d'être égarée. Ce sentiment s'aggrave au cours de la journée suivante et la nuit d'après, qu'elle passe très agitée, elle sort au milieu de la nuit, en rue, nue, ce qui évidemment provoque très rapidement l'intervention de la police, qui dans ces cas-là arrête les choses, et l'amène à l'hôpital psychiatrique.
Elle sort nue en rue… Alors, ce n'est pas banal, parce que d'une part ça situe qu'elle était extrêmement égarée, mais surtout, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce cas, - c'est ce que Lacan appelle le " retour du signifiant dans le réel " - c'est qu'à la question " qui es-tu, toi ? ", là où elle enrobait ça de son histoire familiale, elle a rencontré, on pourrait dire, un vide de signification, une impossibilité à situer son être de façon précise, ou plus précise que par les rapports imaginaires de sa famille qu'elle présentait ; et elle est sortie en rue en réalisant son nom, parce que son nom, en arabe, signifiait " fille de plaisir ", ou à peu près cela. Je ne connais pas le terme arabe. Et donc elle sort en rue, nue, pour faire la prostituée, la fille de joie. Réalisation du nom, qui fait donc retour du signifiant dans le réel, comme dit Lacan.
À la question " qui est-elle ? ", rien ne répond. Il manque une signification et cela fait retour dans le réel. On voit là la structure du déclenchement. Il y a le surgissement d'un vide de la signification de son être à la demande de l'autre, et juste après se produit le désordre de l'ensemble de ses repérages imaginaires, des significations qu'elle a dans le monde. Elle essaie donc de se raccrocher à ce signifiant, qui fait alors retour comme ce qu'elle a à réaliser, de ce fait.
La réponse du sujet, dans ce cas-là, après plusieurs jours d'égarement, après être arrivée à l'Hôpital Sainte-Anne et s'être un peu apaisée, a été de commencer à construire un délire. C'est le délire comme une réponse possible du sujet, comme une invention possible du sujet psychotique en réponse à ce qui lui est arrivé. Son délire, c'est qu'elle expliquait qu'au fond, quand elle était retournée en Algérie, quelque deux ou trois mois avant, sa mère l'avait amenée voir une guérisseuse et que cette femme avait dit un certain nombre de formules magiques, qu'elle n'avait pas parfaitement comprises, et elle avait imposé ses mains sur elle, et depuis lors elle a l'idée qu'elle est devenue bimane, dit-elle. C'est un délire qui commence, parce que je l'ai entendu en présentation de malade alors qu'elle était depuis quelques jours à l'hôpital et que le délire commençait à se construire en réponse à ce qui lui était arrivé. Délire qui commence à se construire comme explication de ce qui a provoqué ce désordre du monde. " Bimane ", c'est un néologisme, n'est-ce pas ? Le terme existe en français et veut dire, en fait, ceux qui font usage des deux mains ; ce qui n'est pas le cas des humains, de façon générale. Et quand elle le disait, ça avait valeur d'une signification singulière, elle ne voulait pas dire : comme tout le monde je fais usage de mes deux mains. Elle était, là, spécialement devenue bimane, ça avait une signification un peu comme " ambidextre ", c'est-à-dire capable d'utiliser de la même manière les deux mains, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ce n'était pas exactement ça.
Au fond, c'est l'invention d'un néologisme qui vient, hors sens, - c'est un terme qui n'a à priori pas de sens - réparer la signification. C'est ce caractère de travail réparateur d'une invention comme celle-là, ou plus largement d'une invention délirante, donc, qu'elle commençait à faire, mais qui n'était pas encore déployée, autour de la guérisseuse. C'est l'invention d'un terme comme celui-là ou d'une construction délirante qui vient commencer à réparer la trame imaginaire, c'est-à-dire la trame des significations qui s'est défaite. Et c'est ce qui fait dire à Freud - il dit ça dans Les cinq psychanalyses, dans son étude du Président Schreber - que " le délire est un processus de guérison ". Le délire est un processus pathologique, mais en tant qu'il est processus de guérison, c'est-à-dire élaboration, par le sujet d'une invention, d'une construction qui vient tenter de réparer les significations du monde qui se sont perdues en construisant une signification qui nous apparaît folle, mais qui, néanmoins, pour le sujet, redonne signification au monde.
Le néologisme, plus précisément, qu'est-ce que c'est ? Au niveau linguistique, le néologisme, c'est l'invention d'un signifiant nouveau qui n'est pas encore dans le code, ou c'est un nouvel usage sémantique d'un signifiant existant déjà. Ce sont les deux manières dont les linguistes définissent le néologisme. Le néologisme psychotique est plus précis que cela. C'est en effet un signifiant nouveau ou un nouvel usage sémantique du signifiant - c'est le cas dans bimane, d'ailleurs - mais qui renvoie à toute la signification qui glisse, qui échappe ; qui renvoie à la signification qui s'est défaite, qui vient signifier l'ensemble de ce qui n'est pas signifiable par le sujet. Notez que le néologisme, c'est quelque chose que nous produisons à l'occasion, de temps en temps, et parfois pour notre plus grand plaisir, quand nous faisons un mot d'esprit.
Le mot d'esprit, c'est l'invention d'un signifiant nouveau, l'invention d'un signifiant qui n'est pas déjà dans le code. Lorsque Freud extrait ce mot d'esprit , classique depuis qu'il l'a relevé, qui vient d'un ouvrage d'Henri Heine, de ce monsieur qui explique comment il a rencontré Rothschild, dont il dit qu'il le traitait de manière tout à fait famillionnaire… On voit bien, dans ce mot d'esprit, l'invention d'un mot avec les significations que ça peut avoir pour le sujet dans l'affaire, mais ce mot d'esprit, famillionnaire, c'est un néologisme, au sens strict du terme.
La différence avec le néologisme psychotique c'est que dans le Witz - le mot d'esprit : Witz, c'est le terme allemand - le néologisme, c'est certes un message qui n'est pas dans le code, un message donné à l'autre et qui n'est pas dans le code, mais néanmoins qui fait appel à l'Autre pour en accepter la validité. Quand on sort un mot d'esprit, on attend que ça fasse rire, et quand ça fait rire, ça veut dire que l'autre reconnaît que ça vaut et donc, en effet, ça vaut dans le code comme invention. Il y a donc appel à l'Autre pour attester la validité de l'invention.
Dans le néologisme psychotique, la situation est un peu différente. Il n'y a pas d'appel à l'Autre pour attester de la validité de la signification et en effet, à Éric Laurent qui lui demandait : " Bimane, qu'est que ça veut dire ? Expliquez-moi un peu ", elle a répliqué : " Mais vous le savez ! ", avec l'idée qu'en effet, ce signifiant lui est déjà imposé par l'Autre, comme le signifiant qui vient arrêter les significations. Alors, ce surgissement d'un réel qui, chez cette dame, est arrivé suite à la question posée : " Qui êtes-vous... qui es-tu, toi ? ", ce surgissement d'un réel peut apparaître sur un mode plus mineur. Le mode le plus mineur d'apparition de ce surgissement, c'est ce que, dans la psychiatrie classique - psychiatrie classique, c'est-à-dire la psychiatrie du début du siècle - on appelait la " signification personnelle ". La signification personnelle, c'est le sentiment que quelque chose signifie pour le sujet, mais qui garde sa dimension complètement énigmatique. Une de mes patientes psychotiques m'avait ainsi raconté le premier phénomène qui lui était apparu. C'était un jour, quand elle était à la mer du Nord, avec sa mère, en train de se promener sur la plage, - la mer du Nord c'est une mer où, à l'occasion, il y a de grands vents - par un moment de levée de ce grand vent, elle avait eu le sentiment que tout le monde venait vers elle sur la plage. À partir de là, ce premier sentiment l'avait laissée dans une grande perplexité. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, n'avait pas la moindre idée de ce que ça pouvait vouloir lui dire, mais elle avait malgré tout le sentiment que ça s'adressait à elle.
Ce type de signification personnelle, c'est, au fond, la réduction la plus minimale de ce que Lacan appelle le " phénomène élémentaire ", et ça provoque pour le sujet une perplexité, c'est-à-dire que ça laisse en panne de signification. Le sujet est dans une certaine incertitude quant à la signification qui lui vient de l'Autre, mais en même temps, cette incertitude quant à la signification qui lui vient de l'Autre lui donne corrélativement une certitude, aussitôt. C'est que c'est adressé à lui, ça le concerne, donc c'est un signe de l'Autre qu'il ne décode pas. C'est la certitude psychotique, en tant que distincte de la croyance du névrosé, la croyance du névrosé étant, disons, une certitude vacillante. Certitude et croyance, certitude psychotique et croyance du névrosé sont opposées par Lacan de façon très précise en plusieurs endroits de ses textes, d'abord dans ses Écrits, dans un texte qui s'appelle Propos sur la causalité psychique, où il dit comment un sujet qui se prend pour un roi est fou, mais un roi qui se prend pour un roi l'est tout autant, faisant référence là, d'ailleurs, à Louis II de Bavière.
Certitude, c'est-à-dire absence de vacillation dans l'identification. Je prendrai ensuite un exemple de la vacillation dans l'identification. Ici, le sujet se croit, dans ce cas, autre qu'il n'est, et c'est ce qui fait sa certitude. Dans le texte D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, Lacan revient sur cette question de la certitude . Au fond, nous en avons un exemple, notamment, dans les phrases interrompues de Schreber, où le sujet entend des voix. Il entend une voix qui lui dit une première partie de la phrase, qui est ensuite suspendue, avant qu'il ait lui-même à continuer la deuxième partie de la phrase. Et ces voix ont toutes la structure de ce type-ci : première partie de la phrase, qu'il entend comme voix " maintenant je vais me… " ; deuxième partie, qui est ce par quoi il est amené à devoir compléter ce que la voix lui a dit " …me rendre au fait que je suis idiot ". L'enjeu, là-dedans, c'est que quand il entend la première partie de la phrase, qui est seulement constituée de shifter, c'est-à-dire de la dimension de ce qui indique le sujet dans le code : " maintenant je vais me… ", la seconde partie de la phrase ne lui est pas dite par l'Autre, mais lui est comme absolument imposée dans la certitude que c'est ce qui complète la première partie. Cette seconde partie est l'injure qui lui tombe dessus, est la dimension qui réduit son être à être un déchet, dimension fixée de l'identification psychotique, pétrifiée sous cette dimension du déchet que l'Autre lui impute d'être.
Il en est tout autrement des vacillations de la croyance du côté du névrosé. Lacan renvoie, dans le Séminaire XI où il en parle, à un exemple que je trouve très beau sur cette vacillation de la croyance chez le névrosé. C'est un petit exemple qu'il prend chez Casanova. Casanova, grand séducteur, a écrit des mémoires de trois mille pages environ, où de page en page vous avez la série de ses récits de séduction de jeunes dames ou de demoiselles, mais aussi la série de ses récits de magie, disons d'escroqueries, dont il vit. Parce que Casanova n'a pas de biens, il va de demoiselle en demoiselle et en attendant, il lui faut bien trouver un peu d'argent ; alors, certes, il y a des femmes plus riches, mais il y en a d'autres moins riches, et pour gagner de l'argent, il opère un certain nombre de manœuvres magiques. Il se fait passer régulièrement comme magicien ou comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Disons que c'est un homme qui ne manquait pas de culot. C'est le seul fragment de récit dans son œuvre où, en effet, il y a une vacillation, parce que, il faut bien le dire, dans toutes ses mémoires, dans les quelques milliers de pages, il n'y pas de vacillation : il va d'une certaine satisfaction à une satisfaction suivante.
Mais à une occasion, en effet, il vacille. Il arrive dans une ferme où il sait que le maître de maison a l'idée qu'il y a un trésor caché quelque part. C'est une tradition qui raconte cela et ce maître de maison a déjà fait beaucoup de tentatives pour essayer de trouver son trésor. Quant à Casanova, il va se présenter là comme un magicien qui va pouvoir déterrer le trésor. Il demande pour cela des honoraires et il nous dit bien qu'évidemment, lui-même n'y croit pas, qu'il n'y croit pas du tout, qu'il arrivera néanmoins à y faire croire l'autre et que, bien sûr, ça ne marchera pas, mais qu'il arrivera à expliquer à l'autre pourquoi ça n'a pas marché, mais que ça marchera une prochaine fois, et en attendant il sera payé.
Donc, il arrive là et il y a toute une longue manœuvre où il a besoin d'une jeune vierge qui lui donne son bain, etc. Je vous passe les détails des entours de séduction qu'il y a dans l'affaire, et puis il opère sa manœuvre, qui consiste en ceci : il se met au centre d'une cour, le maître de maison étant au balcon, et il dessine par terre un certain nombre de signes cabalistiques avec un cercle ; il se met à l'intérieur du cercle de ces signes cabalistiques, il lève les bras au ciel pour invoquer les puissances divines afin que simplement, on trouve le trésor. Et au moment où il lève les bras au ciel et invoque les puissances divines, en disant bien, donc, que lui n'y croit pas, - que lui n'y croie pas, remarquez, c'est ça sa croyance, c'est une croyance comme une autre : celle de ne pas y croire - et au moment où il lève les bras au ciel, donc, éclate juste derrière lui un gigantesque orage qui le met dans une frayeur épouvantable, au point qu'il danse sur place ; il n'ose plus sortir de son propre cercle, avec l'idée que seul ce cercle le protège et, comme il le dit lui-même : " Je m'étais mis à croire à mon propre ouvrage ". Au fond, voilà la dimension de la croyance névrotique, la dimension de la vacillation qui va avec toute croyance. Toute croyance implique qu'on puisse effectivement, sous le terme suivant, en douter un peu, quitte à reprendre sa croyance, ce que fait d'ailleurs Casanova parce qu'après, il continue à croire quand même que la prochaine fois il n'y croira pas. Mais, dans ce moment saisissant pour lui, - au fond, ce qu'on pourrait penser, ce qu'il pense volontiers être une certitude : " Je ne crois pas dans ces ouvrages de magie que je fais " - il se démontre croyant, donc avec la possibilité de vacillation de sa croyance.
Alors, par rapport à ces phénomènes de certitude qui tournent autour du surgissement d'un signifiant dans le réel, - ce sont les exemples que je vous donnais tout à l'heure - d'un signifiant qui fait signe au sujet, je voudrais dire qu'on a un grand repère de la clinique différentielle entre certaines psychoses, entre la psychose paranoïaque et la psychose schizophrénique. Alors que du côté de la paranoïa - je dis " du côté " parce que ce sont les deux grands pôles que je situe là, je ne veux pas faire une classification - du côté de la structure paranoïaque, - Lacan et Freud l'étudient à propos du cas Schreber - du côté de la paranoïa, nous avons en effet le surgissement d'un signifiant dans le réel et nous avons la tentative par le sujet de réparer la trame du rapport des signifiants aux significations. Comme je vous disais tout à l'heure. Du côté de la schizophrénie, au contraire, ce qui surgit, c'est un phénomène dans le corps ; ces " retours dans le corps ", comme s'exprime Lacan, peuvent être très variés : ce sont les grands phénomènes schizophréniques mais aussi, parfois, des phénomènes plus subtils.
J'ai, il y a un certain nombre d'années, fondé une institution pour enfants psychotiques et je veux vous évoquer, à propos de ces phénomènes de retour dans le corps, des fragments cliniques de deux de ces enfants, qui sont explicites de ces phénomènes de corps. L'un, qui est un enfant qui était extrêmement perturbé, extrêmement déjeté, extrêmement peu localisable même dans l'espace, à l'occasion du travail fait avec lui, s'est apaisé. Lorsqu'une éducatrice, une intervenante, s'est retrouvée avec lui dans un travail d'atelier devant un miroir - avec l'idée, sans doute, que ça pouvait l'aider à constituer une certaine image de lui - eh bien dans le miroir, elle lui a fait observer : " Qu'est-ce qu'il y a derrière toi dans la pièce ? " Parce que dans le miroir, on voit aussi ce qu'il y a derrière soi dans la pièce. Il disait : " Là, le piano, là, la table, le meuble, le cadre qui est en face " ; il était assez joyeux de tout ça, et à un moment elle pointe son doigt sur son image dans le miroir : " Et là, qu'est ce que c'est ? ". Cet enfant, après un moment de perplexité, a répondu " un pull-over ", situant un fragment de son corps, et même pas de son corps, je dirais un fragment de ce qui fait la surface de son corps.
Un autre enfant où le phénomène est plus intéressant du point de vue du retour dans le corps, parce que dans le premier il s'agit au fond d'un fantasme de morcellement, d'un phénomène de morcellement… Le second enfant est un enfant d'origine nord-africaine, qui aimait beaucoup manger, et spécialement du couscous. À l'époque, d'ailleurs, où il s'est retrouvé dans cette institution, qui s'appelle Le Courtil, on a mangé assez souvent du couscous parce qu'il aimait beaucoup ça ; donc on en a fait et un jour son père lui a dit : " Fais attention, parce que si tu manges autant de couscous, ton ventre risque d'éclater ". Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il s'agissait de manger, - et pas seulement du couscous, le phénomène s'est étendu assez largement - quasi entre chaque cuiller de son repas, il soulevait son pull-over, regardait son ventre et demandait : " Est-ce qu'il va éclater ou je peux encore manger une cuiller ? ". On voit là comment il s'est mis à être joui par l'Autre dans son corps. La parole de l'Autre s'est mise à risquer de se réaliser dans son corps, comme événement provoqué par l'Autre. C'est ce que j'appelle : l'Autre jouit dans son corps. Si bien, d'ailleurs, parce qu'il présentait plusieurs phénomènes de ce type, que cet enfant aussi - qui était par ailleurs extrêmement vif et intelligent, ce n'était pas un autiste, c'était un enfant schizophrène - cet enfant s'est amené près d'une intervenante qui jouait du piano - une intervenante qui joue très bien du piano - et à un moment, elle s'est arrêtée de jouer et il lui a dit " Joue-moi du piano ". Alors elle s'est remise à jouer et il lui a tendu ses mains : " Non ! Joue-moi du piano ". Alors elle lui a cédé sa place, en pensant " tu veux jouer du piano ", et il a insisté en tendant ses mains : " Non ! Joue-moi du piano ", proposant que l'Autre joue de ses mains à lui du piano. C'est-à-dire le côté " être joui par l'Autre ", être un bout de son corps utilisé par l'Autre, c'est ce qu'il proposait là.
Eh bien, si sous l'aspect paranoïaque, les phénomènes d'irruption surgissent donc comme signifiants qui font signes et déchirent le tissu de la signification, dans ces phénomènes schizophréniques, c'est le corps qui est atteint. Dans la psychanalyse, nous connaissons essentiellement deux abords du corps : le corps comme image, le corps, au fond, comme unité, le corps comme moi, c'est-à-dire le corps animé d'un sentiment de la vie. Je prends là l'expression à Lacan, " le sentiment de la vie ". C'est le corps construit sur le semblable, construit sur l'image de l'autre pour se donner image à soi. Et nous avons l'autre aspect du corps, qui est le corps comme objet, comme objet pulsionnel, objet toujours partialisable, le corps comme objet des pulsions partielles, le corps quand il n'est pas enrobé par l'image, quand il n'est pas enrobé par l'unité du moi. Et dans ces deux cas d'enfance que nous voyons, c'est, au fond, le défaut d'enrobage du corps pulsionnel par l'image, le défaut d'enrobage du corps pulsionnel, partialisé à l'occasion, par l'image.
Je disais que ces phénomènes de corps peuvent se trouver de façon plus subtile et je pensais là à un cas, clinique aussi, mais qui est plutôt tiré d'un roman, du roman de Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein. Lol y est clairement présentée, par Marguerite Duras, - et d'ailleurs elle le confirme dans un entretien avec Lacan - clairement présentée comme psychotique. Lol V. Stein, un certain nombre d'entre vous ont certainement lu ce roman. Lol V. Stein, c'est cette femme qui se fiance, et au moment où elle se trouve au bal avec son fiancé, elle voit son fiancé extrêmement attiré par une autre femme, on peut dire " aspiré " par une autre femme. Elle les voit danser ensemble et aussitôt son amour cesse, dit-elle. Ce n'est pas de la jalousie, c'est qu'elle est saisie absolument par autre chose - on verra tout à l'heure ce qu'était cette dimension de son amour - elle est saisie absolument par autre chose, qui est le corps de cette autre femme. Et le corps de cette autre femme se met à aspirer absolument toute la signification de son être, spécialement sur la robe de cette femme. Et puis, cet homme s'en va avec cette femme et elle reste seule. Après un épisode de vacillation, elle va rencontrer un autre homme, elle va se marier, elle va avoir une vie tout à fait normale dans une autre ville. Mais, comme c'est extrêmement bien décrit par Marguerite Duras, elle va avoir une vie vide ; normale, mais dans laquelle elle ne se trouve pas. Ses enfants vont bien, elle fait le ménage, son mari vient, tout se passe parfaitement, n'est-ce pas, elle est normale, mais déshabitée du sentiment de la vie. Puis, elle retourne dans la ville où s'était passé le bal et où elle avait perdu son fiancé. Mais le problème n'est pas tellement qu'elle avait perdu ce fiancé, c'est plutôt qu'elle avait perdu cette femme. Parce qu'au fond, l'amour qu'elle avait pour ce fiancé, rien ne dit qu'il était plus éminent que l'amour qu'elle a eu ensuite pour son mari et ses enfants, c'est-à-dire quelque chose qui la laissait quand même vide, étrangère à elle-même.
Elle revient dans cette ville et là, donc, elle voit de loin une ancienne amie d'enfance et elle rencontre l'homme qui est devenu l'amant de cette femme. Il y a alors cette série de scènes où elle est dans le champ de blé, où elle voit les amants, spécialement le corps de cette femme déshabillée, apparaître à la fenêtre du petit hôtel sordide où ils vont se rencontrer. Cette scène se répète quelques fois et on y voit Lol revivre, réanimée complètement du sentiment de la vie - animée plus qu'aspirée, d'ailleurs - par le corps de cette autre femme, dans un phénomène où, au fond, c'est cette autre femme, le corps de cette autre femme, comme la robe de la femme du bal, qui lui donne au fond l'image qui l'habille elle-même.
Marguerite Duras situe bien comment le corps de cette femme vient à la place de son propre corps. Et donc, elle se retrouve dans deux situations, Lol V. Stein : soit elle est habillée du corps de l'Autre ou de la robe de l'Autre, soit elle se retrouve vide, perdue, sans vie, mais pouvant animer une vie normale.
Une fois dits ces phénomènes, je voudrais examiner un peu les orientations du traitement, les orientations psychanalytiques par rapport à ces phénomènes qui touchent le corps. Les orientations du traitement, j'entends par là les orientations des traitements que les sujets trouvent, c'est-à-dire les inventions que les sujets se construisent pour répondre à ce qui est arrivé dans leur corps. Alors je vais mettre en série quelques modes d'invention.
D'abord, dans le cas de Lol. V. Stein de Marguerite Duras, dont je parlais, il est intéressant de remarquer qu'il y a le choix de deux positions : soit elle est normale, mais déshabitée d'elle-même ; soit, au contraire, elle est reprise par la vie, mais dans une position où c'est par l'intermédiaire d'une autre et d'une manière qui ne peut - ça se saisit parfaitement dans le roman - qui ne peut que déraper. C'est une position qui ne peut tenir que quelques instants, que pendant un certain moment, qui ne peut que glisser. Cela pose d'ailleurs une question éthique : au fond, que faut-il soutenir dans ce cas ? Que vaut-il mieux ? Qu'elle vive une vie qui apparaisse normale, mais déshabitée, ou qu'elle choisisse d'être habitée par le sentiment de la vie, mais dans une vie qui, par contre, bascule à la folie aussitôt ? Quand je dis " choix éthique ", c'est moins le choix, là, le choix du psychanalyste que celui du sujet qui est en cause, c'est elle qui choisit.
Deuxième type de construction, d'invention du sujet, c'est la construction de traits partiels d'identification qui fixent la signification, à défaut de ce que Lacan appelle la métaphore paternelle, c'est-à-dire du fonctionnement du Nom-du-Père. Je ne veux pas développer la fonction du Nom-du-Père, qu'Antonio Di Ciaccia avait développée. Mais donc, devant ce défaut du signifiant qui fait tenir la signification, devant ce défaut, le sujet qui ne trouve pas suffisamment de significations de ce qu'il est dans l'existence peut essayer de se construire des identifications partielles, des bouts d'identification qui lui permettent de tenir dans un certain nombre de circonstances. J'évoquerais, là encore, pour prendre les choses, comme j'avais annoncé, par un bout très clinique, le cas d'un patient que j'ai vu, après son déclenchement psychotique, et qui a opéré exactement cela : se construire plusieurs identifications qui lui servent selon les moments et les lieux où il est dans l'existence.
C'est un adolescent juif religieux qui se trouvait dans une école juive religieuse d'Anvers - Anvers a une communauté juive religieuse importante en Belgique - et simplement il lui était difficile de suivre les cours, l'enseignement semblait être trop difficile pour lui, et donc il fallait le changer d'école. Et son père trouvait embarrassant dans le changement d'école, que dans ce cas, il devrait aller dans une école mixte. Parce qu'il faut dire que la plupart des écoles courantes en Belgique - en dehors, en effet, de certaines institutions organisées, comme certaines écoles juives religieuses - la plupart des écoles sont mixtes. Et, du fait des préceptes de la religion, mais aussi de l'entourage, son père trouvait qu'on ne pouvait pas le mettre dans une école mixte. Alors il était extrêmement embarrassé, ce que son fils comprenait ; et finalement, son père l'a mis dans une école mixte à Strasbourg.
Alors son fils me disait bien, quelques mois plus tard, parce que je l'ai vu après toutes une série d'épisodes entre temps, il me disait bien comment il ne comprenait pas pourquoi, pour son père, c'était possible de le mettre dans une école mixte à Strasbourg et pas à Anvers. Or nous, nous comprenons tout de suite, évidemment. C'est que son père tenait aux semblants sociaux locaux et que, localement, il était très gêné de le mettre dans une autre école, on pouvait très bien comprendre cela. Au fond, à distance, ça ne le gênait plus du tout. Toujours est-il que le fils, ça le rendait très perplexe.
Il est allé ensuite dans un institut en Israël et là, c'est là qu'il déclenche, à l'occasion de la rencontre d'un juif venu de Norvège et dont lui a eu le sentiment que c'était un juif extrêmement curieux parce qu'il avait les cheveux blonds. Il déclenche, il va à l'hôpital psychiatrique, il est rapatrié en Belgique, à l'hôpital psychiatrique, et après un temps de passage à l'hôpital, il va dans une institution de type post-cure, une " ressource " comme on dirait ici. C'est à partir de là qu'il vient chez moi, deux ou trois mois après ça.
Il m'explique ceci : c'est qu'au fond, maintenant, les choses se sont apaisées pour lui, parce que maintenant il sait, quand il va à Anvers, qu'il est un juif religieux et il s'habille en conséquence. Par contre, quand il est à Bruxelles, où il fréquente essentiellement le quartier où se trouve cette petite ressource, il me dit : " Je sais que je suis un post-cure ", et ça va aussi. On voit là la construction de deux petites identifications qui lui permettent de circuler dans deux mondes en étant quelqu'un de localisé. Sa difficulté, simplement, c'est qu'il était amoureux d'une fille qui est catholique et que ça lui paraissait plus difficile de se situer dans la famille de cette fille, dans laquelle il avait déjà été. Alors il avait bien eu l'idée de lire le Nouveau Testament de la Bible, mais ça lui paraissait interdit, jusqu'à un jour récent où il avait découvert que le Nouveau Testament avait été traduit en hébreu. " Alors, me dit-il, dans ce cas-là, je vais pouvoir le lire et ça me permettra peut-être de devenir un catholique en hébreu pour pouvoir aller dans la famille de mon amie ". Voilà donc des tentatives dont la troisième, quand même, il faut bien le dire, est au moins fragile. Ce sont des tentatives - par un sujet psychotique, dont le monde a complètement vacillé - non pas de construire un grand délire, il n'a pas fait ça, mais de refabriquer une série d'identifications qui lui donnent une situation, une signification, un être, disons, présentable, dans un certain nombre de circonstances précises.
Mais ces sujets ont aussi, à l'occasion, un autre mode d'accès à un traitement singulier de ce qui leur arrive, un autre type d'invention possible, dont je voudrais dire un mot, parce que ça me paraît spécialement intéressant : c'est l'ironie, l'ancrage du sujet par un point de non-sens. L'ironie, je prends ma référence aussi d'un article écrit par Jacques-Alain Miller sur la clinique ironique. L'ironie vise la dévalorisation de l'Autre, la réduction de son sens au non-sens. On comprend pourquoi, d'ailleurs, ça aide le sujet à traiter ce qui lui arrive ; c'est dans la mesure où, au fond, le schizophrène, ou le sujet psychotique atteint dans son corps par l'Autre, a deux solutions en quelque sorte : soit il délire ou il opère une construction identificatoire comme ce que je vous mentionnais là, et il se donne une nouvelle signification des valeurs du monde et de ce qu'il est lui-même, soit il ironise et donc il dévalorise les significations imposées par l'Autre. Il vise la destruction de l'Autre. L'ironie a ses lettres de noblesse, en particulier Socrate, dont on sait comment, en effet, l'enseignement opérait par le moyen de l'ironie. C'est-à-dire, au fond, comment il disait à ses contradicteurs : " Vous avancez telle thèse, très bien ! Examinons-la ! " Et par une série de questions, au fond, les amenait à devoir finalement reconnaître la dévalorisation complète de cette thèse. Il y avait une dimension ironique, dans ce traitement que Socrate faisait de ses adversaires.
Cette ironie du schizophrène est, à l'occasion, une manière très utile de traiter l'Autre qui l'envahit, qui l'envahit jusque dans son corps. Dans l'institution en question, encore une fois, dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pu observer un jeune adolescent qui a produit ce petit trait ironique amusant. C'est qu'un jour… Il s'était extrêmement apaisé et, au fond, apaisé comment ? C'est en devenant extrêmement obséquieux. Progressivement, il avait construit un langage d'une très grande obséquiosité, d'une politesse excessive à l'égard de l'autre, à l'égard de tous les autres, et remerciant de façon excessive pour des choses qu'on ne lui avait même pas données, je veux dire, vraiment, dans cette dimension de soumission entière à ce que pourrait être un caprice de l'Autre. Évidemment quand la soumission est telle, on voit bien, déjà, que ça ne l'est plus tout à fait, parce que quand on est trop obséquieux, ça déstabilise en même temps l'Autre par rapport auquel vous l'êtes. Mais toujours est-il que lui a produit ceci, qui va un peu plus loin. Il avait changé de groupe dans l'institution et, un jour, le directeur administratif de l'institution vient dans ce groupe, comme il y va de temps en temps, " visiter " entre guillemets. Mais ce jeune venait d'y arriver depuis peu de temps et donc il dit : " Monsieur le directeur, je vais vous faire visiter mon nouveau groupe ". Donc il l'emmène aux divers endroits en lui disant " c'est vraiment très gentil d'être venu me voir où je suis maintenant etc. " Et au moment de sortir, le directeur lui dit au revoir en le remerciant beaucoup de lui avoir fait visiter l'institution, et ce jeune lui dit, sur le pas de la porte : " Mais, monsieur le directeur c'est un grand plaisir pour moi de vous foutre dehors ". Au fond voilà un trait d'ironie, une invention ironique qui va dans cette dimension de l'obséquiosité, mais qui traite l'envahissement toujours possible de l'Autre.
Mais, après tout, c'est aussi l'essentiel du travail de Joyce, bien que ce ne soit pas le seul travail qu'il opère. James Joyce fait, lui, une invention d'une grande ampleur, élevée à la dimension de la littérature. Joyce n'est pas un psychotique déclenché, mais il présente bien un certain nombre de phénomènes où Lacan peut voir la structure de la psychose. J'en citerai deux, notamment ses Épiphanies, n'est-ce pas ? Ce sont des sortes de petites ritournelles, en tout cas de petits thèmes fixes et sans équivoque et, à ce titre, proches du phénomène élémentaire, comme des pensées qui s'imposent et que Joyce, au fond, va ensuite disposer à un certain nombre d'endroits de son œuvre. Mais surtout, je voulais insister sur d'autres phénomènes que Lacan relève également, d'autres phénomènes qui surgissent chez Joyce et particulièrement un phénomène de corps, un phénomène qui témoigne de l'absence de narcissisation de son corps, c'est-à-dire de l'absence d'enrobage par l'image de son corps. Lacan relève en particulier une scène du Portrait de l'artiste, où Joyce nous explique comment, au bord d'un chemin à l'occasion d'une discussion philosophique et littéraire avec des camarades, dans un désaccord violent, il se retrouve tabassé par eux et que, après cela, laissé au bord de la route, il est étonné lui-même de ne pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'affect à ce propos, et il a l'idée, il lui vient l'idée que son corps a été laissé là, comme une pelure au bord du chemin, comme un corps sans image, sans moi, sans investissement narcissique. Et Lacan va, au fond, reprendre cette question-là pour montrer comment l'œuvre de Joyce va être à la fois une œuvre, donc, de déconstruction de la langue anglaise - l'œuvre de Joyce est essentiellement une œuvre de travail sur la lettre même de la langue, qui va déconstruire la langue anglaise par un certain nombre de procédés, en particulier par les équivoques translinguistiques - et c'est dans cette déconstruction de la langue anglaise que je vois le trait ironique de Joyce, au fond, de venir détruire l'Autre. Il faut dire, un Autre avec lequel il avait un rapport ambigu, parce qu'il était lui-même irlandais. Et avec cette déconstruction de la langue anglaise, Joyce se construit une œuvre, mais que Lacan appelle aussi son " sinthome ", écrivant d'ailleurs de l'ancienne écriture française : " sinthome ", qui équivoque avec Saint-Thomas. La thèse de Lacan est que ce sinthome de Joyce, c'est la construction d'un corps hors corps, la construction qui vient se substituer à l'investissement narcissique qui manquait et qui, à la fois, lui donne un nom. Joyce parle d'ailleurs, à propos de son œuvre, de recréer la conscience incréée de sa race ; comme il parle aussi de ce que son œuvre va donner du travail aux universitaires pour plusieurs siècles, ce qui au fond, va lui produire un nom pour plusieurs siècles ; et en même temps, cette œuvre constitue aussi, pour lui, ce travail ironique dans lequel il participe à une dimension de jouissance : le travail de la lettre.
Je voulais vous dire un mot, aussi, à propos d'un autre auteur qui a présenté un déclenchement de psychose, qui est un grand poète français : Gérard de Nerval, qui a écrit son déclenchement psychotique dans son œuvre littéraire, dans son œuvre poétique et, c'est ce qui fait l'extraordinaire de ce cas, c'est de décrire son délire immédiatement en termes poétiques. Son délire lui vient en termes de poésie dans le texte Aurélia. Ce qui survient à Nerval, lors du déclenchement de son délire, porte sur le joint le plus intime du sentiment de la vie et du sujet.
Alors brièvement, l'histoire de son déclenchement, c'est ceci. Six ans avant sa première crise, il rencontre une femme et il est très lucide lui-même sur le procès d'idéalisation qu'il fabrique de cette femme. Je vais vous en lire un passage (cette femme est actrice et il va la voir jouer au théâtre) : " Indifférent au spectacle de la salle, celui du théâtre ne m'arrêtait guère, excepté lorsqu'à la seconde ou à la troisième scène d'un maussade chef-d'œuvre d'alors, une apparition bien connue illuminait l'espace vide, rendant la vie d'un souffle et d'un mot à ses vaines figures qui m'entouraient. " Donc, une femme dont il situe là la dimension, bien sûr, d'idéal de retour de vie qu'elle vient rendre, mais dans un maussade chef-d'œuvre. Et il est encore plus explicite dans Aurélia, ce texte sur sa psychose. " Quelle folie, me disais-je, d'aimer ainsi d'un amour platonique une femme qui ne vous aime plus. Ceci est la faute de mes lectures. J'ai pris au sérieux les inventions des poètes et je me suis fait une Laure ou une Béatrice d'une personne ordinaire de notre siècle ". Il dit bien comment il a élevé Aurélia à la dimension d'une idéalisation et comment cette idéalisation est ce qui le soutient, ce qui soutient, au fond, son sentiment de la vie comme je vous l'exprimais tout à l'heure.
Au fond, le déclenchement a lieu lorsque va se rompre cette idéalisation, lors d'une rencontre qui va rompre cette idéalisation. Donc, Aurélia, il la voit un certain temps et puis elle ne veut plus le voir. Il ne la voit plus. Et il a alors, à un moment, une brève rencontre avec une dame qui est une dame de qualité, comme il dit, mais, au fond, qui lui apparaîtra toujours comme une femme assez ordinaire ; et de cette femme, néanmoins, il commence à s'éprendre un peu, puis il essaie de lui écrire une lettre d'amour, et aussitôt la lettre écrite et envoyée, il lui apparaît que les mots qu'il a utilisés pour cette femme sont les mots mêmes qu'il utilisait pour Aurélia et que c'est là une profanation : " J'empruntais dans cet enthousiasme factice les formules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m'avaient servi pour peindre un amour véritable et longtemps éprouvé. J'avais franchi en un jour plusieurs degrés des sentiments que l'on peut concevoir pour une femme avec apparence de sincérité. " Et donc, il est amené ensuite à avouer à cette femme, parce qu'il n'arrive plus, dit-il, à " retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style ", il est amené à lui avouer que ce n'est pas elle qu'il aime. Au fond, tout ça est factice. Il se sépare d'elle, il ne la revoit plus. Et puis quelque temps plus tard, il se retrouve par hasard, dit-il, dans une autre ville, en l'occurrence Bruxelles, dans une autre ville où justement, par hasard aussi, Aurélia et cette femme se trouvent et ont fait connaissance. Un jour de réception, il se trouve à la réception et ces deux femmes également, Aurélia et cette femme ordinaire. Et à ce moment-là, c'est là que se produit le déclenchement psychotique. À ce moment-là, un hasard les fit connaître l'une à l'autre et la première - c'est-à-dire la femme que je dis ordinaire, mais qui est donc une femme de qualité mais non idéalisée - la première eut l'occasion sans doute, dit-il, " d'attendrir à mon égard celle qui m'avait exilé de son cœur de sorte qu'un jour me trouvant dans une société dont elle faisait partie je la vis venir à moi et me tendre la main " - Aurélia, donc. Donc voilà, petit geste d'Aurélia et perplexité du sujet. " Comment interpréter cette démarche et le regard profond et triste dont elle accompagna son salut ? J'y crus voir le pardon du passé, l'accent divin de la pitié donnait aux simples paroles qu'elle m'adressa une valeur inexprimable, comme si quelque chose de la religion se mêlait aux douceurs d'un amour jusque-là profane et lui imprimait le caractère de l'éternité. " C'est bien dit en termes poétiques, n'est-ce pas ? Mais ce caractère de l'éternité est déjà le signe du dérapage qui se produit exactement à ce moment-là. Il doit quitter Bruxelles, il doit rentrer à Paris brièvement et à son retour à Paris, donc le lendemain ou le surlendemain, en effet, se produit la dégradation imaginaire que je vais vous lire dans un instant
Mais, au fond, que s'est-il passé à ce moment-là ? Aurélia est marquée, maintenant, part le fait que c'est la femme ordinaire - suppose Nerval - qui a convaincu Aurélia que, quand même, il n'était pas si mal que ça. Et en plus, Aurélia vient lui dire bonjour, vient faire un geste ordinaire, sans doute sous l'influence de cette autre femme. Et immédiatement, ça rompt cette dimension d'idéalisation au profit d'une énigme, d'une perplexité du sujet de ce que peut vraiment signifier ce geste. " Aussitôt rentré à Paris, vers minuit le surlendemain, je remontais un faubourg où se trouvait ma demeure lorsque, devant les yeux, par hasard, je remarquai le numéro d'une maison éclairée par un réverbère. Ce nombre était celui de mon âge. Aussitôt, baissant les yeux, je vis devant moi une femme au teint blême, aux yeux caves, qui me semblait avoir les traits d'Aurélia. Je me dis : c'est sa mort ou la mienne, qui est annoncée. Je ne sais pourquoi je me tins à la première supposition et je me frappai de cette idée que ce devait être le lendemain à la même heure. " Là est précisément le déclenchement. Après cet épisode que je viens de vous relater, il se retrouve là, brusquement, saisi par un signifiant, c'est-à-dire le chiffre de son âge, qu'il voit par hasard, et le visage de cette femme qui ressemble à Aurélia, qu'il voit l'instant d'après ; il en conclut, immédiatement, une perte de vie pour lui, perte de vie qui va devoir être réelle. Et en effet, il passe toute la journée du lendemain dans une assez grande excitation en attendant l'heure fatale et à l'heure fatale, le monde se déchire, la rue se transforme et il est peu après amené à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il se met à errer dans les rues avec un sentiment de grande perdition, mais aussi de modification complète de l'espace dans lequel il circule.
Et il a alors, et c'est sur ce point-là que je veux conclure... Et il présente un phénomène imaginaire qui est le suivant. Donc, Nerval, je dirais d'abord que c'est encore un autre type de psychose. C'est une mélancolie psychotique qui répond exactement de la définition qu'en donne Freud : lors d'une perte subie, ici en l'occurrence celle d'Aurélia idéalisée, " l'ombre de l'objet, dit Freud, tombe sur le moi ", c'est-à-dire que le moi disparaît, le moi comme sentiment de vie du sujet disparaît, ne laissant que le corps comme objet, comme déchet dévalorisé. Il n'est plus rien. Et ce corps laissé va en effet se retrouver dans un grand embarras, puisque vont survenir un certain nombre de phénomènes qu'on dit " de double ", dont je vous donne ici le premier exemple. Il y en a plusieurs. Il est amené à l'infirmerie du dépôt, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, dans un premier temps, et… " Les soldats s'entretenaient d'un inconnu arrêté comme moi, et dont la voix avait retenti dans la même salle par un singulier effet de vibrations. Il me semblait que cette voix résonnait dans ma poitrine et que mon âme se dédoublait. Et quelques instants plus tard, je vis près de moi deux de mes amis qui me réclamaient pour me faire sortir de l'hôpital. Les soldats me désignèrent, puis la porte s'ouvrit et quelqu'un de ma taille, dont je ne voyais pas la figure, sortit avec mes amis, que je rappelais en vain. " Mais on se trompe, m'écriais-je : c'est moi qu'ils sont venus chercher et c'est un autre qui sort ". Je fis tant de bruit que l'on me mit au cachot. " Donc là, on a ce phénomène de dissociation, du corps qui reste là comme pelure et de l'image qui s'en va, n'est-ce pas ? L'image, sous la forme du double, va s'accentuer encore pour revêtir plusieurs aspects, et Nerval va avoir plusieurs moments féconds. Son délire va durer quinze ans, au bout de quoi on le retrouvera suicidé, pendu à une grille d'une rue à Paris. Mais lors d'un autre moment fécond, des phénomènes du même type apparaîtront et finalement les phénomènes de double vont s'amplifier et aller jusqu'à celui-ci, qui est qu'à un moment, alors qu'Aurélia est morte entre-temps et que d'ailleurs il a rôdé beaucoup autour de sa tombe, à un moment il va avoir l'idée d'un mariage d'Aurélia, qu'un mariage se prépare, que c'est le mariage d'Aurélia et que son double est en train de tromper tout le monde, et que finalement Aurélia est d'accord pour l'épouser, mais qu'elle va épouser ce double parce qu'il fait tromper sur la personne ; ce qui montre encore une fois cette disjonction de l'image et du corps laissé comme déchet, où il se trouve lui-même.
Voilà, je vais en rester là pour ce soir afin de laisser du temps pour quelques questions.
Michèle Lafrance : Merci, Alexandre Stevens. Alors, pendant que vous préparez vos questions, je vais me permettre d'y aller de la mienne.
En fait, j'aurais deux questions, qui touchent deux moments de votre développement. La première, c'est par rapport au néologisme. Vous avez opposé le néologisme côté psychotique et le néologisme côté névrosé qui rejoint le trait d'esprit. Alors vous disiez que le néologisme du côté de la psychose est imposé par l'Autre, alors que le trait d'esprit vise la reconnaissance de l'Autre. Est-ce qu'il s'agit du même Autre ? Et la seconde question, qui touche un autre point de votre développement, c'est concernant l'ironie. Vous avez donné un exemple et vous mettiez cela en rapport avec la schizophrénie, mais est-ce qu'on peut aussi remarquer cet autre type d'invention du sujet psychotique, par exemple, chez le paranoïaque ?
A. S. : Je vais d'abord répondre à la seconde question. Il me semble que l'ironie n'est pas aisée pour le paranoïaque. C'est dommage, parce que ça pourrait lui servir, mais encore faut-il y avoir accès, c'est-à-dire que l'ironie suppose quand même… à moins qu'on ne parle d'ironie grinçante. Évidemment, quand un paranoïaque s'engage dans une série de revendications, il y a le même mouvement que dans l'ironie, c'est-à-dire : détruire l'Autre. Le paranoïaque peut aller jusqu'à l'assassinat, il peut aller se lancer dans des procès fous de revendication à l'égard de l'Autre. Alors, évidemment, on pourrait se dire que c'est de l'ironie grinçante. Ceci dit, ça n'a pas ce caractère de non-sens de l'ironie, n'est-ce pas ? L'ironie, comme je l'entends là, touche le sens pour en faire saisir le non-sens, alors que dans la revendication paranoïaque, le sens est au contraire parfaitement fixé, et s'il y a ironie grinçante c'est du côté d'emmerder l'autre jusqu'au bout, le cas échéant, mais ce n'est pas absolument du côté d'en rire, du " ça n'a pas de sens ".
Cependant, par exemple, on peut aider le paranoïaque, peut-être, à prendre là-dessus, à l'occasion, une position un peu plus ironique. Je pense, là encore une fois, à un jeune que j'ai eu l'occasion de voir dans cette institution, un jeune paranoïaque, alors qu'il était franchement revendicatif, en effet, revendicatif d'abord sur les enseignants de l'école, et sur les membres de sa famille. Ça s'est étendu progressivement, et c'est à cette occasion-là qu'il est arrivé dans cette institution parce que ça devenait, comme on dit, invivable. Et très vite, évidemment, il a fait porter un certain mode de revendications sur l'institution. Il les faisait porter sur les défauts de l'institution. Il y a toujours des défauts dans les institutions, mais remarquez, il y en a partout - ce que j'appelle " institution ", c'est ce que vous appelez ici " ressource ". Je le dis parce qu'il faut s'entendre sur les mots. Donc, il s'est très vite fixé sur un truc, c'est qu'il n'y avait pas assez d'eau pour prendre sa douche chaude, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants et sans doute les chauffe-eau sont peut-être insuffisants, je n'en sais trop rien. Il est venu se plaindre de ça.
Comment on a essayé de traiter ça, nous ? C'est en lui donnant raison et en lui disant qu'il fallait absolument écrire ça, il fallait aller en parler au directeur, il fallait voir ce qu'on pouvait faire. Évidemment, on ne pouvait faire grand-chose et il est revenu en nous disant qu'on ne pouvait pas faire grand-chose et on se mit, nous, alors, à se moquer de l'institution en disant " Pffft ! " On n'est pas l'institution quand on est intervenant dedans, n'est-ce pas ? " C'est terrible ici, c'est quand même pas bien comme institution, les robinets coulent pas. " Alors ça, c'est quand même une tentative d'introduire là un peu d'ironie sur l'Autre qui est nous-mêmes ; au fond c'est faire porter une barre sur l'Autre. C'est barrer partiellement l'Autre. Là, je pense à ce cas-là, parce que c'est sur un mode un peu ironique. Alors lui il a pu, avec ça, se construire tout un délire de robinet qui a apaisé les choses, mais je ne dirais pas que lui a jamais pris vraiment cette position ironique. Lui, plutôt, il a été soutenu, et sa revendication s'est apaisée et a pu passer par un certain nombre d'arcanes, par le fait que nous, au fond, on ne tenait pas la signification correcte de l'institution, que c'est nous qui disions " Tu sais, on ne vaut pas grand chose… L'institution, ça n'est jamais qu'une institution ". Je pense que l'ironie du paranoïaque, c'est difficile à imaginer, il me semble, sauf sur ces points limites que je dis là.
Sur le néologisme, est-ce le même Autre dans l'Autre psychotique et l'Autre du névrosé dans le cas du Witz, du mot d'esprit ? Oui et non. D'abord, il faut dire qu'évidemment le Séminaire V, dans lequel Lacan développe cette thèse sur le mot d'esprit, ce développement sur le mot d'esprit, est un séminaire de la même année que son texte sur la psychose, où il est question, spécialement, du néologisme. Les deux références que je prenais sont de la même année de l'enseignement de Lacan. Alors c'est le même Autre au sens où, au fond, c'est l'Autre où se détient un certain code des signifiants, c'est l'Autre du langage de Lacan. Ça passe à l'occasion par un autre à qui on parle, mais c'est au-delà de l'autre à qui on parle, l'Autre du langage dans les deux cas, ici. L'Autre où se constitue l'ensemble du code signifiant. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le même Autre. Sauf que l'Autre, dans la névrose, est un Autre qui reste relativement décomplété, alors que l'Autre, dans la psychose, qui en effet envahit le sujet voire envahit son corps, est un Autre qui jouit de lui. Par un certain aspect de l'Autre, on peut dire que ce n'est pas le même, mais je pense que l'Autre qui sait - dans la psychose - qui sait déjà la signification du mot, parce qu'au fond c'est lui-même qui l'a imposé, pourrait-on dire, pour le psychotique, et l'Autre qui reconnaît la valeur du Witz, il me semble qu'on peut dire que c'est le même Autre, à cette nuance près, du rapport à ce que l'Autre en jouisse ou pas.
Raymond Joly : Je crois que c'est dans le Livre II du Séminaire de Lacan qu'il y a cette phrase " L'Autre, ne vous gargarisez pas de ce mot " et je ne peux dire que Lacan ait été un excellent exemple lui-même de la mise en pratique de son précepte. Je persiste à croire que ce n'est pas une bonne chose, pour des gens qui se livrent à quelque discipline de l'esprit que ce soit, d'employer régulièrement le même mot dans une quinzaine de sens différents en laissant toujours l'interlocuteur deviner quel est le sens qui s'applique dans ce cas-là. Je crois honnêtement que... j'oserais dire nous tous, j'oserais me mettre dans le " nous ", que nous, lecteurs disciples de Lacan, nous devrions faire un petit effort pour mettre un peu d'ordre dans notre terminologie.
Vous voyez très bien que j'enchaînais sur la question de Michèle et sur la réponse très sage et très fine que vous y avez donnée. D'autre part, c'est aussi une question de terminologie que je voudrais simplement signaler, sans apporter aucune espèce de solution. Le mot " ironie " ne vient pas de la psychanalyse, évidemment ; il vient de la rhétorique, et son origine est très complexe, parce que c'est un mot qui apparaît en grec d'une façon très bizarre, à propos de Socrate, et ce n'est pas tellement évident ce que ça voulait dire à l'origine. Toujours est-il que là aussi, il y aurait du travail à faire, je crois, pour la clarification des termes, et j'ai trouvé extraordinairement passionnante l'introduction de l'ironie dans votre discours sur la psychose, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant et je me suis demandé si nous aurions profit à nous demander s'il s'agit d'ironie ? Si oui, dans quel sens ? Il s'agit certainement d'ironie dans l'un des sens que nous donnons communément à ce mot, ou s'agit-il d'humour ? Je me suis rappelé des distinctions que Freud lui-même essaie de mettre au clair à propos de ces deux termes. Alors je ne sais pas quel usage on peut faire de ça. Quand Freud parle de l'humour, dans le livre sur le trait d'esprit par exemple, c'est pour évoquer une certaine économie des rapports entre le surmoi et le moi. Alors le surmoi et le moi, nous en parlons toujours mais nous n'en parlons pas autant, me semble-t-il, que Freud ne le faisait lui-même. Alors je ne sais pas... il me semble que monsieur Stevens serait, d'après ce qu'il vient de nous présenter, serait éminemment apte à faire cela. Je me demande s'il n'y aurait pas un approfondissement précieux à faire de ces notions d'ironie et d'humour, par exemple, en les faisant intervenir dans le cadre de la psychose ce que, je crois, Freud n'avait jamais fait.
A. S. : Vous me concéderez que du moi, j'ai parlé plus tôt, n'est-ce pas ? Oui, ironie et humour, je pense que ce n'est pas la même chose, en effet, n'est-ce pas ? Je vois bien comment les psychotiques peuvent être sensibles à l'humour et comment ça peut apaiser un certain nombre de choses. Au fond, l'humour peut-être utile de la part de l'intervenant dans une ressource ; l'humour peut-être utile s'il allège la situation. Après tout, ce que j'évoquais là du paranoïaque, avec ces problèmes de tuyauterie, était aussi avec un certain humour mais, à l'occasion, cela peut prendre plus de place que ça ; si ça allège un peu le poids de ce qui arrive au sujet, l'humour peut être très utile.
Par contre, je pense que l'ironie est plutôt, dans le cas précis de la psychose et spécialement dans le travail en institution, à laisser aux psychotiques. Parce que ironiser... ce qui distingue l'ironie de l'humour, comme je l'utilise là, en tout cas, c'est au fond que l'ironie vise l'autre... - d'accord ne mettons pas l'autre à toutes les sauces - l'ironie vise celui qui est en face. Dans certains cas, ça vise au-delà de celui qui est en face, là on peut dire l'Autre n'est-ce pas... Mais l'ironie vise celui qui est en face, et elle a quelque chose qui détruit. Il suffit de voir, en effet, vous vous rappelez que le terme vient à propos de Socrate, mais c'est un terme de rhétorique, en effet. Au fond, la rhétorique socratique est, pour une part, empreinte d'ironie ; sa manière de traiter ses adversaires consiste à ironiser, à ironiser à propos de leurs théories, de leurs propositions, et de les mettre dans la contradiction.
Alors ce qui me semble de particulier à l'ironie, ce n'est pas seulement que ça attaque l'autre, que ça vise celui qui est en face, mais c'est qu'en plus, ça vient ajouter du non-sens ; là où il y avait du sens, ça vient défaire le sens. Moi, c'est cet aspect-là de l'ironie qui m'intéresse très spécialement dans le traitement de la psychose, mais j'entends bien traitement du côté du traitement que le sujet trouve lui-même, et pas le traitement qu'on lui donne de l'extérieur ; c'est-à-dire son invention, dans les exemples que j'ai donnés.
Donc, l'ironie à la fois détruit l'autre… " détruit " est peut-être fort mais peut aller jusqu'à détruire celui qui est en face, en tout cas. Quand on lit spécialement les premiers dialogues de Socrate, l'autre se retrouve au bout de ça un peu ridicule quand même. C'est ça que j'appelle " détruit ", c'est pas vraiment détruit, mais c'est quand même - disons le - un peu défait, et en même temps ça défait le sens, c'est-à-dire là où il y avait une proposition pleine de sens, au bout de ça, le sens n'y est plus. Donc l'ironie à la fois attaque l'autre, qui soutient une certaine position, et en même temps défait le sens de ce qui est soutenu comme position. C'est ce qui me paraît spécialement intéressant du schizophrène, mais spécialement intéressant aussi pour nous, comme analystes. Du côté du travail même de l'analyste, la question... il ne s'agit pas d'ironiser alors dans ce sens-là, mais la question de ce qu'il s'agit de faire, quand on défait le sens, quand on amène le non-sens, est au cœur aussi de la dimension analytique, c'est largement ça. De cette façon on peut décaler par rapport à ce que je dis là du schizophrène. Je dis ça pour dire qu'on peut apprendre quelque chose, ainsi, du schizophrène.
Donc, il me semble que les exemples que je donnais sont du côté de l'ironie, mais que l'humour a aussi sa place avec la psychose, sa place dans le traitement de la psychose, mais un peu différente. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'humour défait nécessairement le sens. L'humour a à voir avec le surmoi et le moi, mais ça ne défait pas forcément le sens. Au fond, l'humour défait l'image, davantage. L'humour joue sur une image qui tombe, qui casse, et ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la destitution du sens, me semble-t-il. Je distinguerais la chose comme ça.
Alors, évidemment, quand cette ironie va… parce que c'est ainsi, en tout cas, que je prends... je ne réduis pas tout le travail de Joyce à être de l'ironie, mais je pense qu'une face du travail que Joyce opère sur la langue anglaise elle-même est un travail d'ironie. Là, je dirais que ce qu'il défait, c'est le sens de l'Autre comme tel, d'un Autre qui est bien au-delà de son interlocuteur qui est l'Autre de la langue anglaise, dont on sait aussi comment, effectivement, comme irlandais, il avait un rapport à ça qui était d'une certaine ambiguïté. C'est à la fois la langue dans laquelle il écrivait, mais en même temps la langue de l'étranger.
Fabienne Espaignol : J'avais une question par rapport à la certitude du psychotique, par rapport au doute, à la croyance qui a amené au doute chez le névrosé. En fait, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit par rapport aux mères avec leur bébé, ou aux femmes avec leur mari, qui ont la certitude de comprendre ce que l'autre ressent parfois, ou ce qu'il pense et qu'il ne dit pas. Je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment du côté de la croyance avec un certain doute, j'ai l'impression qu'on est du côté de la certitude et pourtant je n'ai pas l'impression qu'on est psychotique pour autant.
A S : Oserais-je la boutade qui vient de Lacan : " Toutes les femmes sont folles "... bon... Non, au fond, effectivement, d'une mère à l'enfant, quelque chose peut se sentir qui semble au-delà de la croyance. D'une femme au mari... peut-être, mais il y a des chances que cette femme, à une autre occasion, comme Casanova, découvre qu'au fond, ce qu'elle avait comme certitude est en fait justement mis en cause. Cela seul permet de le situer comme croyance. D'ailleurs, au fond, d'une mère à son enfant, comment ça se passe ? Vous le savez mieux que moi, sûrement. Mais quand l'enfant vient à naître... prenons simplement un moment, là, à l'entrée de la vie, à l'entrée du langage. Cet enfant crie et puis très vite, la mère va interpréter ce cri. Elle va se dire : là, il a faim, là il a envie d'être pris dans les bras. Alors, je ne sais pas si c'est une certitude, mais ça m'inquiéterait que ce soit une certitude. C'est une interprétation. C'est par cela même qu'elle le fait entrer dans le langage, c'est par cela même qu'elle le fait entrer dans un désir qui ne ravale pas l'ensemble sur les besoins. Plus qu'une certitude : elle entre là dans la dimension de l'engager du côté du désir.
Fabienne Espaignol : Je suis d'accord avec ça et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a autre chose ; qu'il n'y a pas que ça, mais je ne sais pas l'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a une connaissance très intime de l'autre et c'est étrange, parce qu'en même temps, effectivement, on ne le connaît pas et on n'est pas folle dans ce sens-là, on sait qu'on ne le connaît pas, et en même temps, parfois, on a l'impression de le connaître. Par exemple, quand le père est là et qu'il est proche de l'enfant, c'est pas qu'il est absent, il est présent, il y a des trucs qu'il ne comprend pas, mais pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là ? Est-ce que c'est juste de l'interprétation ou est-ce quelque chose de l'intime de l'autre qui nous donne une espèce de certitude qui n'est jamais vérifiable, et puis en même temps, à un moment donné, on s'aperçoit que oui, on ne se trompe pas nécessairement. Et je crois que par rapport au conjoint aussi, des fois on est à côté de la plaque complètement, mais aussi, il y a bon nombre de fois où il me semble que des hommes disent : " Oui, tu me comprends, mais je ne te demande pas de me comprendre, je ne te demande pas de dire ce que je ne dis pas, que je ne me dis même pas à moi-même ".
A. S. : Oui, enfin, ce dont vous parlez, c'est de la dimension de l'intuition. La certitude du psychotique est une certitude plus logique que cela, qui ne porte pas sur le sentiment d'une compréhension, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, mais plutôt sur le fait que quelque chose se passe dont je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais dès lors que se trouve incertaine la signification qui vient là, ce qui tout de suite apparaît certain, c'est que ça vient vers moi. C'est le contraire d'une intuition, n'est-ce pas ?
Dans l'intuition, c'est plutôt : " je ne suis pas sûr qu'il a envie que je le dise et même, d'ailleurs, il m'a déjà dit qu'il ne fallait pas que je le dise parce que lui-même n'a pas envie nécessairement de le savoir, mais j'ai compris que... " Si vous voulez, c'est l'envers d'une certitude, cette intuition. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Quand même, la certitude du psychotique, ce n'est pas plus dans la vérité, ce n'est pas ça, puisque c'est une certitude folle. Quand cette femme dont je parlais a le sentiment que tout le monde vient vers elle sur la plage, c'est une certitude folle, mais c'est une certitude au sens où c'est une certitude logique et dont elle ne démordra pas. Au moins, ça c'est certain.
Reine-Marie Bergeron : Il y a un point que j'ai trouvé intéressant et je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, Alexandre. C'est, finalement, quand j'ai entendu dernièrement une infirmière en psychiatrie dire " Voilà, le patient est psychosé. ", et puis une semaine après il ne l'est plus. Alors, me demandant ce qu'elle voulait dire et entendant ce que tu disais tout à l'heure de cette femme qui sortait en rue, on peut dire qu'il y a comme deux mouvements : l'acte qui est sans repère, là où il y a une perte complète de repères dans le temps, dans l'espace, et ensuite, la tentative de guérison, qui est la construction du délire. Mais il me semble qu'il y a un " après-délire ", c'est-à-dire quand les patients viennent finalement consulter, après leur sortie d'hôpital ou d'institution ; à ce moment-là, ils peuvent essayer de faire une construction sur la construction, également.
A. S. : Oui, évidemment, la thèse de Lacan, tu la connais bien d'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est qu'on n'est pas psychotique à certains moments et névrosé à d'autres. La thèse de Lacan, c'est que ça relève d'une position de structure, c'est un certain type de rapport à l'Autre du langage, à la jouissance, à sa propre existence, à ses propres significations. C'est une position différente d'être névrosé ou psychotique, de ce point de vue-là, et cette position est de structure.
Ceci dit, évidemment il faut bien s'entendre qu'à partir du moment où la chose est située comme ça, la structure psychotique n'est pas, au fond, une tare jetée sur le sujet. Nous savons comment des psychotiques peuvent avoir été parmi les plus grands auteurs, en tout cas de productions éminentes. J'ai évoqué Nerval, Joyce. Joyce, qui n'a jamais déclenché. Si on considère la psychose comme seulement le moment où la chose dérape, Joyce, on dirait évidemment qu'il n'est pas psychotique. Si Lacan le considère comme psychotique, c'est parce qu'il prend les choses du côté de la structure. Cantor qui, lui, a déliré, a néanmoins inventé les nombres transfinis. Rousseau est quand même un phénomène de la littérature, une langue classique superbe, une œuvre monumentale, il faut bien le dire, délirante. Quand il invente son traité d'éducation qui s'appelle L'Émile, il faut le lire, ça ! L'Émile, qui servait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, de référence aux éducateurs. Il faut aller lire la dimension délirante de la chose, c'est-à-dire construire une éducation... il le dit en ces termes-là ! On en est étonné aujourd'hui ! Il s'agit de construire l'éducation d'un enfant telle que : il faut répondre à toutes ses demandes si elles correspondent à des besoins et surtout ne pas y répondre si elles correspondent à des désirs. Ça, c'est fou, ça. Et en termes lacaniens : demande, désir, besoin, c'est formidable !
Mais Lacan considère la structure de la psychose. Ça ne veut pas dire : en permanence dans les phénomènes de déclenchement de dégradation de l'imaginaire. Donc, tu as bien raison ! Distinguons, en effet, le moment de la rupture lors du déclenchement, où l'imaginaire - c'est-à-dire les significations, aussi bien significations du sujet lui-même que significations du monde ou une partie de ça - se défait, défaille. Le sujet est perdu et alors, effectivement, il peut passer dans des actes complètement fous, comme on dit au sens courant du terme, - cette femme qui n'aurait sans doute jamais imaginé qu'elle allait se balader nue comme ça va se promener nue en rue.
Après ça, il y a le processus de guérison, qui n'est pas toujours le délire - je vais vous donner quelques exemples - mais le délire en est le classique, en effet. Le délire peut ensuite se réduire et, en effet, se limiter à un point de certitude qui reste, mais tout ça est enkysté, et par ailleurs le sujet retrouve une vie normale, c'est-à-dire avec beaucoup de phénomènes qui ressemblent aux phénomènes névrotiques, n'est-ce pas ? Néanmoins la structure reste présente, du point de vue de Lacan. Donc ça n'empêche pas qu'un psychotique puisse guérir, non pas de sa psychose comme structure, mais guérir du phénomène qui a surgi. Les exemples les plus majeurs de cela, tous les cliniciens ont vu ça, n'est-ce pas ? C'est spécialement à l'adolescence, quand se produisent les éruptions de phénomènes psychotiques, c'est quand même spécialement à l'adolescence qu'on voit des réparations qui ont l'air tout à fait complètes du monde du sujet.
Alors en plus, la remarque que tu fais sur " les constructions sur les constructions " est intéressante. C'est vrai, après un délire on peut voir ça, mais remarque qu'on peut même le voir pendant le temps du délire, parce que ce n'est pas parce que le sujet est fou, - je dis ça en termes courants pour dire le côté où ça dérape complètement - c'est pas parce qu'il est parti dans cette dimension délirante qu'il ne peut pas garder toute une partie d'esprit critique. On voit des sujets intelligents qui à la fois ont une certitude psychotique, avec un élément délirant autour de ça et qui, néanmoins, gardent une dimension absolument critique, y compris par rapport à ce point-là. Si bien que certains peuvent absolument saisir, même, que c'est psychotique. Ça, c'est " la construction sur la construction " la plus parfaite qui puisse se faire, jusqu'à saisir ça. Mais même dans le moment le plus délirant, il peut y avoir une persistance, Freud le fait remarquer, de l'esprit critique.
Pierre Lafrenière : J'aimerais beaucoup vous entendre parler sur le cas que vous nous avez présenté de cet adolescent juif que vous avez reçu finalement en analyse, c'est-à-dire je crois qu'il s'est présenté en vous adressant une certaine demande. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage, et puis ce que vous lui avez proposé dans les entretiens qui ont suivi.
A. S. : En effet, il est venu me voir quand il était au centre de post-cure et je l'ai vu pendant un certain temps, et puis il a cessé de venir me voir, et puis il est revenu me voir un an après. Donc j'ai un certain suivi dessus. Il y a eu tout un premier temps pour l'aider à soutenir la possibilité de fonctionner dans le monde, avec ses repères qu'il se construisait lui-même. En même temps qu'il a cherché un travail, il gardait une extrême difficulté avec son père, qui vient précisément du fait qu'il ne peut pas comprendre cette approximation non logique de son père. " On ne peut pas le mettre dans un collège mixte ", ça, il peut comprendre, n'est-ce pas ? Mais " on ne peut pas l'y mettre, sauf à Strasbourg ", c'est quelque chose qui lui reste totalement énigmatique et sans doute n'a-t-il pas pu, d'ailleurs, le faire éclaircir par son père lui-même. Donc, à la suite de cela, il est resté dans une extrême méfiance à l'égard de son père dans toute la dimension de projet qu'il pouvait avoir. Et alors, par rapport à ces trois traits identificatoires de substitution dont je vous ai parlé, le trait d'aller lire la Bible en hébreu, je n'ai pas soutenu cela du tout. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas le faire, n'est-ce pas ? Je lui ai demandé si c'était bien nécessaire. Parce que ça me paraît quand même, là, déraper très fort d'aller penser devenir un catholique en hébreu. Il y a quelque chose, là, qui devient une espèce de compromis étrange qui, à mon avis, est difficile à soutenir. Toujours est-il qu'à la suite de cela, il n'en a pas eu besoin, surtout parce que cette femme qui était, elle, une grande hystérique, par contre, cette femme le soutenait pas mal du tout et elle-même considérait que ce projet n'était vraiment pas nécessaire et que sa mère n'était pas si catholique que ça, etc. Et que, au fond, ils s'étaient tous les deux connus dans le centre de post-cure et ça suffisait comme ça. Donc il a fait l'économie de ce trait-là. C'était une invention en projet. Ensuite je ne l'ai plus vu et il est revenu me voir un an et demi après. Son père était entre-temps décédé et il s'est retrouvé brusquement… Évidemment, c'est là qu'on ne peut pas toujours prévoir ce qui va survenir lorsque survient un événement dans la vie d'un sujet comme ça. Il s'était brusquement retrouvé investi d'avoir à soutenir sa mère, la petite entreprise de son père, etc., et extrêmement stabilisé par ça. Il aurait aussi bien pu être complètement déstabilisé, c'est pas absolument prévisible, mais on voit à ça que, sans doute, les approximations de son père devaient être très inquiétantes pour lui. Alors je ne l'ai revu à ce moment-là que quelques fois et je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Je ne peux donc pas en dire davantage.
André Jacques : Dans le traitement des psychotiques, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas particulièrement appuyé son idée de devenir catholique en hébreu. Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous analysez ? Est-ce que vous interprétez ? Quelles sont les interventions thérapeutiques que vous faites ? Est-ce que vous visez la thérapie ? Enfin, j'imagine que oui ! Je parle par rapport aux analystes qui disent que, bon, " la guérison vient par surcroît ". J'imagine que vous n'avez peut-être pas cette position-là, mais qu'est-ce que vous faites avec des personnes psychotiques, et qui soit vraiment analytique ?
A. S. : " La guérison vient de surcroît ", ce n'est pas n'importe qui qui dit ça, c'est Freud. Je suis d'accord avec ça, d'ailleurs.
Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand même la différence, en l'occurrence, dans l'abord de la névrose et de la psychose, fondamentalement, dans la cure analytique. Du côté de la névrose, il ne s'agit certainement pas de ménager au sujet la possibilité de surprise. Au contraire, il me semble que l'analyse ne vise pas à ce qu'il aille mieux, si aller mieux c'est être plus apaisé. La psychanalyse vise à ce qu'il soit moins dans la méconnaissance de son propre être, n'est-ce pas ? La guérison vient de surcroît.
Du côté de la psychose, c'est différent. Je dirais ceci : on peut être tiraillé entre deux positions divergentes à soutenir, et au cas par cas il y a à choisir. Ceci dit, il y a une nuance à ce " il y a à choisir " : c'est qu'avec le psychotique, c'est quand même beaucoup plus souvent lui-même qui choisit et ce dont il s'agit, c'est de soutenir un peu plus ou un peu moins certains éléments. La construction délirante… ce n'est pas l'analyste qui pousse à délirer. S'il construit son délire, ça s'accompagne ; on ne va pas dire : " Et vous ne penseriez pas en plus à ceci ? ", n'est-ce pas ? Mais s'il construit son délire, est-ce qu'on va toujours laisser cela se construire comme ça ? Si ce délire commence à se fixer dans une revendication sur une personne, on ne va pas attendre de voir bientôt l'assassinat, pour essayer de décaler un peu cela, quand même. Il y a tout un travail, là, de décalage.
Je disais tout à l'heure, à propos du cas - certes de la littérature, mais que je trouve très beau de Lol V. Stein parce que très beau, très fin, très subtil, très limite aussi de la question de la psychose - je disais, au fond, qu'on se trouve confronté, à l'occasion, du côté de " que faut-il soutenir ? " La dimension plus énigmatique, plus du côté de la rencontre, mais en même temps plus vivante pour le sujet ? Ou la dimension d'apaisement ? Il me semble que cela dépend des sujets, et qu'il faut les laisser eux-mêmes s'orienter en partie. Je ne vois pas pourquoi le sujet n'a pas aussi le droit à l'apaisement si c'était à un moment sa pente. Je ne serais pas là à le pousser dans des retranchements comme cela peut-être le cas avec le névrosé. Ça c'est les nuances que j'y mettrais.
Maintenant, quand on dit " soutenir une position ", c'est quoi ? Je dis bien que c'est le psychotique qui construit lui-même ; alors, dans le cas de cet adolescent, qui était juif religieux au départ, et qui l'est resté d'ailleurs, mais partiellement seulement, au fond, j'ai eu le sentiment, j'ai l'idée que cette troisième identification était un peu compliquée et très peu logique et qu'elle ne tiendrait pas facilement. S'il avait voulu absolument lire la Bible en hébreu, je ne l'aurais pas empêché non plus ! Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de lui dire " Est-ce bien nécessaire ? ", c'est-à-dire de dégonfler un peu ce qui venait un peu trop comme surmoïque pour lui : " Il faut absolument que je fasse ça pour cette femme ". Et, au fond, avec juste cette intervention-là et le fait qu'il en ait alors parlé à cette femme, elle lui a dit " ce n'est pas nécessaire " et il s'est calmé. Donc, je dirais, là, l'intervention de soutenir quelque chose, ou au contraire de le défaire, se fait sur cette limite subtile-là. Mais, j'ajoute qu'on a les cas de situations dans des moments florides, on ne réagit pas de la même manière que dans des moments où la chose est un peu apaisée et peut s'interroger autrement. Je pense qu'il y a beaucoup de psychotiques qu'on peut pousser, tout à fait pousser à s'interroger sur l'énigme de leur existence, exactement comme des névrosés, du moment qu'on reste attentif au point où cela peut complètement basculer. Le psychotique qui s'est arrangé, à trente ans, pour n'avoir jamais rencontré une femme, il ne faut pas avoir l'idée que ce serait quand même bien qu'il en rencontre une ! Là, il doit avoir ses raisons, je me dis. Donc, vraiment, la prudence, c'est ça. Mais, par contre, l'interroger sur ses positions dans l'existence, ça peut se faire absolument comme avec un névrosé. Le psychotique n'est pas limité de ce point de vue-là. Enfin, ce sont quelques indications. Disons que le traitement psychanalytique, la cure analytique du psychotique demanderait beaucoup de développements et de variétés, davantage que du côté de la névrose.
Alors, le " proprement analytique "… au moins, on peut dire une chose : c'est que si du côté de la névrose, ce qui s'évoque immédiatement, c'est la dimension de l'interprétation… encore que c'est à nuancer, au sens où il faut savoir quelle interprétation, et donc il ne faut pas en remettre sur l'interprétation que fait déjà l'inconscient lui-même sans cesse, parce qu'il y a une dimension interprétation de l'inconscient. Donc, c'est pour cela que Lacan insiste davantage sur la dimension de coupure, c'est-à-dire de l'acte comme tel, qui vient modifier le sujet plutôt qu'interpréter le sens de ce qu'il dit. Ça, c'est le côté de la névrose. Du côté de la psychose, la dimension d'interprétation, ça je m'en méfierais quand même sérieusement, parce que le psychotique, en général, interprète déjà pas mal lui-même. Ce qu'on appelle " analyse ", ce n'est certainement pas en remettre sur l'interprétation, mais pousser le sujet à s'interroger sur ce qui fait cette perplexité de l'existence, ce qui fait l'énigme de son existence, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire aussi.
Jean-Paul Gilson : J'hésitais à intervenir en fonction du cheminement que je te voyais faire dans ton exposé, mais les derniers termes que tu viens de lâcher me donnent envie de te dire que, donc, tu parles de perplexité devant l'existence et, au fond, c'est comme ça que tu as un petit peu parlé de la psychose dans ton opposition entre le désarroi et l'inventivité, ou l'invention, par quoi tu as commencé ton exposé, où est-ce que tu arrives ?
Je me disais - je vais te le dire comme ça : il n'est pas psychotique, Stevens, évidemment il n'est pas psychotique, puisque ce qu'il n'a pas dit revient non pas dans le réel mais dans son discours. Ce qu'il n'a pas dit, c'est les rapports que la psychose entretient avec la sexualité. Et même Freud faisait des choses pareilles. Il disait : " La psychose est un conflit entre le moi et la réalité ". Néanmoins, quand on lit son affaire, on s'aperçoit bien que le problème, c'est la sexualité. Or, on a toujours gardé la sexualité à la névrose, comme tu l'as à l'occasion mentionné tout à l'heure. Mais dans les exemples que tu as cités, à tous les coups tu es revenu, en asymptote ou directement, sur la question de la sexualité. Même l'épisode du jeune homme dans Le portrait de l'artiste, à cet égard, est tout à fait intéressant. Donc, on pourrait discuter longtemps sur la chose, mais dans le récit, immédiatement après, le jeune homme se rue dans une ruelle après s'être fait tabasser et il va voir une fille qui est nue, - si je me souviens bien dans une ruelle ou une maison sordide - donc il y a de la sexualité. Les exemples de Nerval c'est pareil, il y a de la sexualité. Alors, tu insistes beaucoup sur cet exemple du jeune homme anversois, et je te pose la question, là : As-tu rencontré le père ? Lui as-tu parlé, toi ?
A. S. : Non.
Jean-Paul Gilson : Dommage ! Parce que j'imagine que tu l'aurais fait parler de la mère. Et ça, c'est la question de madame, tout à l'heure, qui faisait le départage entre l'amour de la mère pour l'enfant et l'amour de la mère comme femme pour le père. Où est-ce que ça foire, là-dedans, pour que le gosse devienne psychotique ? C'est parce que c'est là-dedans que ça foire, c'est-à-dire : où est-ce qu'il y a équivalence, aussi bien chez Lacan que chez Freud, entre le Nom-du-Père, le phallus, qui est une invention proprement psychanalytique, et l'amour ? Pourquoi est-ce que ces éléments-là sont des éléments cruciaux ?
Moi, j'ai les plus grandes réserves sur ce qui va arriver de l'humanité clonée à cet égard-là, mais je vais peut-être me trouver démenti par la réalité. Mais ce que l'enseignement de Lacan nous a légué, et le travail qu'on fait à partir de Freud, et le travail qu'on fait tous les jours nous laisse entendre que, normalement, ils vont devenir psychotiques. Parce que des enfants qui surgiraient là, sans amour et sans repérage de la fonction du Nom-du-Père et du phallus, ça ne va pas tenir du côté de la signification ; ça va tenir du côté du sens, à mon avis, mais pas du côté de la signification. Et c'est ça, l'enjeu. Je ne sais pas ce que tu en penses... Je te voyais venir comme ça, c'est pour ça que je te dis : remettons les choses de ce côté-là et interrogeons, non pas le déficit comme tel au sens des psychiatres, mais quand même quelque chose qui ne s'est pas écrit, même pas en hébreu… mais peut-être est-ce cela qu'il cherche, quelque chose qui ne s'est pas écrit dans le rapport entre le Nom-du-Père et le phallus.
Alors, on peut gloser là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du phallus ? Est-ce que c'est l'amour de la mère pour le père ? Auquel cas, il y aurait beaucoup de psychotiques. Parce qu'on sait, quand même, qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent de couples où on ne s'aime plus. Est-ce que c'est le choix que la mère fait du symptôme du père ? Comment est-ce que le phallus et l'amour viennent à copuler pour produire quelque chose qui s'appelle le Nom-du-Père et qui, lorsqu'il est défaillant, produit cette rupture des significations ? C'est ça, la question.
A. S. : Merci, Jean-Paul, de faire remarquer comment, dans toute la série des éléments que j'ai amenés, des fragments de clinique que j'ai amenés du côté de la psychose, la sexualité est en jeu, n'est-ce pas ? Ceci dit, elle est en jeu d'une manière très particulière, c'est-à-dire pas du tout comme dans la névrose. On peut ajouter, d'ailleurs, à cette série, Jean-Jacques Rousseau qui, au fond, va se trouver - je le trouve exemplaire de ce point de vue-là - va se retrouver arriver à éviter à peu près tous contacts avec une femme, à l'exception de deux ou trois situations, mais une seule qui va durer un peu ; je ne suis même pas sûr qu'il y en ait deux autres, des situations très limites avec une prostituée. La seule situation où il va se trouver avec une femme pendant un certain temps, c'est une femme pour laquelle, très curieusement, il va trouver un petit nom comme on trouve parfois des petits noms à dire à la femme qu'on aime : il l'appelle " maman ". Ça, il faut le faire quand même, c'est formidable. Et en dehors de celle-là, qu'il appelle " maman ", il n'aura, je dirais, de relations sexuelles avec aucune femme. Sauf une fois, à un moment, c'est la dernière qui apparaît comme un grand amour. Il y a un chemin entre sa maison et la maison de cette femme et quand il va lui rendre visite - tout ça est dit en termes d'un français classique que je ne pourrais reproduire de mémoire ici, mais enfin pour le dire platement, si vous me permettez… donc chacun entend bien qu'il se masturbe sur le temps du trajet et quand il arrive, c'est déjà fait. Donc ça se limite, effectivement, à une sexualité de laquelle il se tient à l'écart et dont il va faire la thèse que je disais, c'est-à-dire construire un enfant dont la sexualité est à l'écart. Et néanmoins, tu as raison de faire remarquer qu'évidemment, déjà de dire : je vais construire un enfant qui aura la chance de ne pas trouver la sexualité… Parce qu'en plus, Rousseau, dans son Émile, commence par dire : le mieux, ça serait qu'on puisse refaire la langue, parce que les mots sont trop équivoques, et quand on dit un mot, déjà, on entend des choses qui ne devraient pas y être. Mais, dit-il aussi - là c'est quand même sa dimension littéraire -les mots étant ce qu'ils sont, plutôt faut-il alors faire attention de prémunir l'enfant, dans l'éducation, de l'atteinte par ces mots-là, par ces équivoques-là.
Et donc tu as raison de faire remarquer comment la sexualité est présente dans toute cette série de cas, mais chaque fois elle est présente comme, justement, devant être d'une certaine manière barrée, d'une certaine manière, ne pouvant pas venir à la place d'un certain lien sexuel, voire d'un certain lien d'amour et de sexualité.
Alors, en effet, cela tient à cette dimension de la place de l'amour, mais pas nécessairement de l'amour entre le père et la mère. Ça, c'est juste, si ça tenait à ce qu'un père et une mère s'aiment pour que les enfants ne soient pas psychotiques, on aurait de moins en moins de névrosés. Mais il me semble que, au fond, la question, tu l'évoques du côté du phallus. Je reprendrais ça aussi avec le dernier enseignement de Lacan, que tu connais bien également, avec la phrase avec laquelle Lacan reprend cette question de la fonction paternelle, non plus du côté de la loi, non plus du côté du désir, parce que, bon, il y a tout le temps de la fonction paternelle dans l'enseignement de Lacan, où le père ce n'est pas simplement la loi qui dit " non ", bien sûr ! Le père c'est plutôt le père qui dit " oui ", c'est-à-dire celui qui, en effet, reconnaît la valeur symptomatique à son enfant, reconnaît la qualité, enfin simplement l'accueille, au retour de l'école : " C'est formidable, ce que tu as fait ! ". Ça passe de cela, à accepter qu'il deviendra pharmacien parce que papa ne l'était pas, ou que sais-je ? Des éléments comme ça.
Évidemment, dans les derniers temps de son enseignement, Lacan bascule complètement et c'est donc le temps de la clinique borroméenne, qui n'est plus tout à fait la clinique du père orientée sur le côté : il y a, ou il n'y a pas la fonction paternelle installée. C'est une clinique organisée sur : comment se nouent des consistances pour le sujet, avec la singularité de son symptôme, avec la singularité d'une invention qu'il fait. Alors la fonction de la sexualité est quand même encore nouée par le père à ce moment-là, mais elle est nouée comment ? Il y a cette phrase-ci, que j'aime beaucoup, c'est : " Un père n'a droit au respect, sinon à l'amour, que s'il fait d'une femme la cause de son désir. " (je cite de mémoire). Alors c'est joli ça, parce que ce n'est pas " il faut que le père et la mère s'aiment ", mais " il faut que le père, lui, fasse d'une femme la cause de son désir ". Il y a un petit mot dedans qui ne me revient pas, c'est dans une sorte de mi-dire, ce n'est pas " mi-dire " qu'il utilise comme mot, mais il y a un petit mot en plus. Donc, il module ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un père jouisseur qui montre bien comment il jouit d'une femme, et puis d'une autre, puis d'une troisième, ce n'est pas ça, évidemment. Ce petit mot, qui modère la chose, vient dire en même temps comment il ne doit pas être un père jouisseur, mais quand même, il doit désirer. Et ça me paraît, en effet, là, l'élément déterminant de ce point-là.
Là, je prenais des exemples de psychotiques qui ont à se tenir à l'écart, qui s'arrangent pour se tenir à l'écart d'une certaine dimension de la sexualité, mais le patient juif religieux dont je parlais, au fond, il ne cherche pas à se tenir à l'écart, il n'a pas de grandes difficultés, tout compte fait, avec ça, sauf qu'il a choisi une femme avec qui ça ne peut pas tout à fait se faire à l'aise. Il y a une certaine barrière, mais la barrière n'est pas à la même place que pour Rousseau, par exemple.
Voilà quelques considérations là-dessus, simplement. C'est vrai que c'est le bout par où on peut mettre la série des cas en série, aussi, le point d'un mode particulier du non-rapport sexuel dans la psychose.