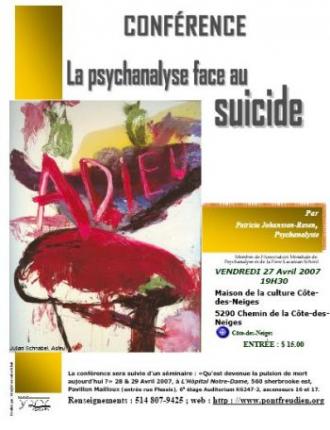
Patricia Johansson-Rosen: Dans nos sociétés modernes, que ce soit d’un côté ou de l’autre de l’océan Atlantique, le suicide est devenu depuis une dizaine d’années un problème de santé publique. Les taux de suicide dans nos pays développés étaient et demeurent en effet élevés.
Ces taux semblent fort peu répondre aux tentatives sophistiquées et coûteuses d’analyse et de maîtrise du phénomène, fût-ce par le biais de la prévention, proposées par nos gouvernements qui, comme vous le savez bien, veulent le bonheur de leurs concitoyens. Pour quantifier votre bonheur, il faut que vous soyez vivant. C’est d’ailleurs pourquoi, quand des personnes se suicident avant 70 ans – je l’ai appris en compulsant les statistiques –,(oui, nous nous devons de vivre mes chers amis jusqu’à cet âge) nos statisticiens de l’OCDE en France, n’hésitent pas à calculer le nombre d’années potentielles de vie perdues (ce qu’on appelle des APVP), perdues pour le pays. Ainsi, dans l’année 2001, 335 années de vie pour 100 000 habitants ont été perdues en France. Il est fort à parier que ceci permet tout simplement d’évaluer le manque à gagner du pays en question. Nous n’avons pas affaire à de grands sentimentaux… Alors que nous avons, semble-t-il, tout pour être heureux au regard de pays techniquement moins développés, il semble bien que le suicide – dont vous savez que les chiffres sont toujours à revoir à la hausse (les chiffres des statistiques donnaient d’environ 20 à 25 %, ce qui veut dire qu’un suicide sur 5 n’est pas reconnu comme tel) du fait de la part d’ombre qui se rapporte à sa reconnaissance (parfois les suicides peuvent passer pour des accidents, très fréquemment) – soit devenu l’une des grandes causes de mortalité. Je n’ai pourtant pas l’impression, en regardant les statistiques françaises de près, qu’on se suicide plus qu’avant, mais bien, plutôt, qu’on meurt moins d’autre chose, de maladies cardio-vasculaire par exemple, en France… Ce qui explique que le suicide était en troisième cause, il est passé en deuxième cause, après les accidents de la route. Quelques chiffres concernant la France. Je suis assez étonnée, j’ai cherché des chiffres récents, et je n’ai pas pu trouver de chiffres plus récents que 2003. Même dans une étude de 2006. Donc il faut beaucoup de temps, semble-t-il, pour recenser les suicides ; ça a l’air très compliqué. Donc :10 500 décès par suicide en 2001, et légèrement plus, 10 660, en 2003. Si on corrige avec la part d’ombre dont je parlais, 25 %, ça fait 13 000, c’est-à-dire environ 2 % des décès de l’année, soit 18 pour 100 000 habitants. Ce qui est à peu près la même chose qu’au Québec. C’est donc la deuxième cause de mortalité de la population française entre 15 et 44 ans, tous sexes confondus, après les accidents de la route, et la première cause entre 30 et 39 ans (soit cela représente 1 décès sur 5 de la population dans la pleine force de l’âge). On constate un taux maximal de suicide chez les hommes de plus de 85 ans. Nous sommes effectivement dans le cas d’un pays où ce sont les personnes les plus âgées qui se suicident, soit 10 fois plus chez les jeunes de 15 à 24 ans. Et encore ne sont pas comptabilisés ce que nous appelons les syndromes de glissement, c’est-à-dire ce qu'on peut observer chez les personnes âgées, moment où parfois elles cessent de manger, de boire, et se laissent dépérir jusqu’à la mort.Une constante : la surmortalité masculine, quels que soient l’âge et le pays concerné. C’est vraiment une constante dans tous les pays. Les hommes meurent environ trois fois plus de suicide que les femmes, alors que les tentatives de suicide, qui sont chiffrées à 200 000 par an (200 000 recensées ; on peut aussi penser à toutes les tentatives de suicide non recensées), alors que les tentatives de suicide, comme vous le savez, sont deux fois et demi plus importantes chez les femmes. La pendaison reste le premier mode de suicide chez les hommes (38 % en 97, 45 % en 2002), puis vient l’arme à feu (16 %) et l’intoxication (15 %). Chez les femmes, par contre, et ça depuis toujours – déjà Freud le notait – c’est l’intoxication, c’est-à-dire l’absorption par la bouche de médicaments, d’alcool et de toxiques qui l’emporte. Sauf que je me suis aperçue qu'au Québec, il semble qu’on vient de comparer les courbes, actuellement, le maximum de tentatives de suicide se fasse par pendaison chez les femmes. On n’avait jamais vu ça.Le maillot jaune – vous savez ce qu'est le maillot jaune, c’est celui qui gagne le tour de France – le maillot jaune de l’union européenne, c’est la Finlande (où l’on doit sûrement rouler prudemment), puis vient la Belgique, l’Autriche, la France et le Luxembourg. C’est en Finlande, effectivement, que la tentative de suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes gens.Si l’on en croit encore les chiffres publiés par le ministère français de la santé, en mai 2006, 8 % de la population de plus de 18 ans aurait déjà fait au moins une tentative de suicide au cours de sa vie. Huit pour cent. Et enfin, 2 % de la population présenterait un risque suicidaire élevé et 2 % un risque suicidaire moyen. Ce qui veut dire que 4 % de la population est suicidaire. Mais je vous épargnerai, si vous le permettez, la description détaillée de la méthodologie de ce sondage tant il me paraît indigent. Je vous dirai seulement, pour vous en donner une petite idée, que ce qu’ils appellent le « risque suicidaire élevé » consiste à avoir dans sa vie déjà fait une tentative de suicide, même 25 ans avant, et, durant le mois précédent, avoir eu une pensée suicidaire. Donc, les critères sont très particuliers.
Le ridicule ne tue pas, fort heureusement. La honte encore, peut-être. Mais enfin, où est donc passée la clinique ? C’est une grande question que nous nous posons parce qu’en France, nous observons effectivement l’entrée du DSM en course ; je pense que nous l’avons depuis moins longtemps que vous, il a fallu un peu plus de temps pour que ça passe l’Atlantique, mais c’est bien arrivé. Alors, est-ce que la dilution progressive des entités morbides de notre nosographie classique, dilution aboutie dans le fatras des troubles proposés par les DSM successifs qui sont au service, non pas de l’être humain, mais des grands groupes pharmaceutiques, suffit à expliquer cela ? Je ne le crois pas, même si, voyez-vous, elle en est l’instrument.
Je pense que cela répond plutôt à un fantasme assez répandu de maîtrise du monde. Nos sociétés sophistiquées veulent contrôler l’humain, c’est-à-dire maîtriser la vie humaine. Il est désormais possible de contrôler les naissances ou de favoriser la procréation, de guérir ou de stabiliser bon nombre de maladies, de réanimer et maintenir en vie pour le meilleur comme pour le pire, hélas, parfois. Ceci a bien sûr toutes ses lettres de noblesse, quand ça n’est pas pour le pire. Et il ne s’agit pas ici de faire la fine bouche devant les énormes progrès scientifiques, notamment médicaux, de nos pays nantis.Mais la psychanalyse pense que c’est peine perdue d’avance, face à la pulsion troublante qui n’a jamais de cesse, tant que la vie anime votre corps, de croire un seul instant que tout de l’humain sera un jour quantifiable, prévisible et enfin contrôlable. Pas plus la dissection des activités neuronales des cerveaux humains que la lecture du génome de chacun ne changeront cette donne qu’est la jouissance pulsionnelle du corps parlant.Ça n’est pas nouveau. De tout temps, se suicider a existé. De tout temps, se suicider a dérangé l’ordre établi par la civilisation qui tente depuis l’aube des temps de réguler les débordements sexuels et autres désordres pulsionnels des corps en présence dans la communauté. La politique, la culture, l’éducation, l’enseignement, les religions ont bien sûr ici joué leur partie en tentant par différents procédés (résumons-les ainsi : la carotte ou le bâton) de canaliser ou de ramener à la raison tout ce qu’il y avait de déraisonnable, d’excessif en chacun.Un peu d’histoire…Dans son livre, Histoire du suicide, la société occidentale face à la mort volontaire, (Fayard, Paris, 1995), Georges Minois, qui est un historien, évoque le fait qu’au cours des siècles, il y a eu des moments marquants où l’idée du suicide a changé. Dans l’antiquité gréco-romaine, le suicide est un acte tout à fait admis ; il est même spécifiquement dit dans la loi romaine que le suicide par fatigue de vivre est un motif acceptable. Le Romain qui en avait assez de vivre passait devant une sorte de comité d’éthique qui soupesait ses raisons et qui lui donnait l’autorisation ou pas de se suicider. Alors il faut dire quand même que ça, c’était valable pour les citoyens libres, pas pour les esclaves, les condamnés et les soldats. Eux, il leur fallait vivre. Ils ne disposaient pas de leur corps. Alors Samson, le Samson de la Bible, a été au fond le premier kamikaze, et ça a posé quelques problèmes à l’Église. Mais c’est surtout à partir de Saint Augustin que le suicide est devenu un péché. Le « Tu ne tueras point » concerne bien évidemment la personne propre, et la vie donnée par Dieu ne peut être retirée sans son accord. La vie n'appartient plus au sujet qui la supporte.
Le suicide, s’il est un attentat contre Dieu, est aussi un attentat contre la société puisqu’il prive la société d’un de ses membres, donc on handicape cette société. Je ne peux pas m’empêcher de penser que les années de vie perdues, cela ressemble drôlement à ça. Un interdit absolu est porté sur cette pratique, avec la religion donc. Le christianisme va venir ajouter une caution spirituelle à des motivations sociopolitiques des états. C’est-à-dire qu’à l’époque, on se comptait : plus on était nombreux, plus on était forts.Dans l’Antiquité, le corps était une propriété de la personne (si elle était libre). Au Moyen-Âge par contre, apparaît le moment où le corps appartient à Dieu, d’où cet usage du jugement du cadavre qui a, rendez-vous compte, duré jusqu’au XVIIIe siècle en France. Le cadavre, évidemment, du suicidé. Il y avait d’une part le jugement du cadavre, en sa présence, et puis, d’autre part, son exécution. Il s’agissait de faire subir au corps une punition. Il était retourné face contre terre, pendu par les pieds avant d’être brûlé, et ses cendres dispersées. La punition infligée au cadavre visait à l’anéantissement de ce corps. Le corps qui était sacré dans la religion devient diabolique et on lui fait subir le traitement qui convient. Enfin qui convient, euh… si l’on veut. Enfin, qui convenait au démon qui l’habitait, ce corps. Depuis Saint Paul, le dualisme est très net entre la partie noble qui est l’âme et la partie méprisable, périssable, qui est le corps. La renaissance remet le suicide au cœur des préoccupations. D’une part, l’intérêt pour l’Antiquité avec ses suicides célèbres et le constat que les anciens aient eu une position positive à l’égard de l’acte du suicide pose question. D’autre part, c’est aussi une période de remise en cause des grandes valeurs fondamentales de l’époque ; un certain doute s’est introduit dans le domaine du savoir de façon générale, tout est bouleversé, avec les grandes découvertes et les débuts du capitalisme. On assiste à une désagrégation profonde des liens traditionnels et l’individu se sent plus isolé. Le suicide, entre les années 1580 et 1620, est devenu un problème de société. On s’en aperçoit notamment dans la littérature, le roman, le théâtre, comme chez Shakespeare. Ophélie se suicide par exemple. Dans le théâtre shakespearien, vous avez des suicides. Ce qui semble assez nouveau par rapport à ce qui se faisait avant. Ce débat intellectuel, progressivement, va devenir un problème de société au XVIIIe siècle, car les autorités religieuses ou politiques vont réagir en durcissant leurs positions face à ces nouvelles idées sur le suicide. La justice royale en 1670, en France, promulgue une grande loi, qui fait du suicide un crime équivalent à un crime de lèse-majesté et c’est le moment des grands procès aux cadavres, dont j’ai parlé précédemment. Au XVIIIe, le siècle des Lumières, de vastes débats publics vont être organisés, sur le thème « Est-ce que le suicide est un acte de courage? » Cela s’amplifie jusqu’à la période de la révolution, où le suicide est dépénalisé dans la plupart des pays du continent. Au XIXe siècle, réaction contraire, qui suit l’évolution des mentalités et des moeurs. C’est le moment, comme vous le savez, de la révolution industrielle et de la montée du scientisme. Le scientisme s’oppose au suicide. C’est l’époque d’une société utopiste, dans laquelle l’individu est au service du groupe et n’a pas la libre disposition de sa personne. Le suicide est condamné. Sur le plan religieux – là aussi j’ai été assez stupéfaite – il semble que le XIXe siècle soit l’époque la plus stricte. Alors que l’enterrement des suicidés était admis au XVIIIe, on revient à une condamnation et au refus des prêtres d’enterrer les suicidés. Il semble que le taux de suicide ait relativement peu varié, depuis l’antiquité jusqu’à l’ancien régime. Enfin il faut dire que le comptage... maintenant, déjà, il faut trois ans pour avoir des chiffres avec tous les moyens que nous y mettons, alors à l’époque ! Mais selon l’historien – je vous conseille de lire ce livre, c’est très intéressant – il semble qu’au fond, le suicide s’est maintenu à un taux relativement constant. Au XIXe siècle, il semble y avoir un accroissement du nombre de suicides peut-être dû à l’évolution vers ce que l’on appellera le modernisme. Là, les chiffres ont franchement augmenté. Le relâchement des liens sociaux, le développement industriel, avec l’exode de la campagne vers les villes, le travail des enfants, les mauvais traitements, l’alcoolisme, le capitalisme sauvage, beaucoup de traits du monde contemporain se mettent alors en place en même temps. Il semble, selon cet historien, que le débat se soit déplacé actuellement sur l’euthanasie, qui est un autre terme pour le suicide, particulièrement présent en France et il tourne donc plutôtautour de la question de la fin de vie. Est-il permis à l’individu de quitter la vie, quand il s’aperçoit qu’il n’a plus rien à en espérer ? Le suicide des jeunes, néanmoins, préoccupe la société française. Donc, vous voyez, depuis toujours il y a eu des hommes qui se sont suicidés. La part de liberté radicale que comporte tout acte, suicidaire en particulier, mais on pourrait inclure l’acte créatif, l’acte suicidaire qui est l’acte réussi par excellence selon Lacan, bien au-delà du véritable drame humain qu’il représente pour les proches, dérange toujours nos sociétés. Il paraît de nos jours insensé, c’est-à-dire fou, au sens psychiatrique du terme, de préférer la mort à la vie. Le suicide héroïque n’aurait plus droit de cité. Que faisons-nous alors des attentats-suicides, cette nouvelle forme de terrorisme ?On traque tous azimuts avec des échelles d’évaluation (qui ne sont pas le top du lien social) le syndrome dépressif et autres maladies mentales pour prévenir le passage à l’acte suicidaire. On cherche d’arrache-pied le dérèglement sérotoninergique, cible privilégiée des antidépresseurs, voire l’anomalie génétique. La clinique psychanalytique met en évidence que le « syndrome dépressif », les passages à l’acte ou les idées suicidaires ne sont pas des entités cliniques, et ne sont pas corrélatifs d'une seule structure.
La psychanalyse ne saurait évidemment pas se satisfaire non plus de critères sémiologiques superficiels – fût-ce ceux de la psychiatrie classique, qui disparaît – phénoménologiques, cognitivistes, neuro-scientifiques, ou du DSM, ni même de la simple évaluation du caractère de gravité d’un tableau clinique pour différencier un travail de deuil difficile d'une inhibition névrotique grave ou d'un apragmatisme mélancolique.À cette difficulté, la réponse contemporaine de l'individualisation réductrice de syndromes dits « objectifs », dont celle de l'entité « dépression », mène d'évidence, par amalgame ou approximation, à des confusions diagnostiques, mais aussi à des risques thérapeutiques. Notamment, prescrire des antidépresseurs dès qu’on a affaire à quelqu’un qui est déprimé, ou pseudo-déprimé, peut entraîner des passages à l’acte. Lever – sans savoir ce que l’on lève – une inhibition peut être très dangereux. Donc il vaut mieux avoir un outil. Ainsi, pourrait-on dire, c’est cette réponse du discours médical contemporain, du discours du maître, qui met toujours plus en évidence l'acuité de l'outil que Freud et son lecteur Lacan nous ont légué.Je vais faire un aparté, parce que vous savez qu’en France, nous sommes en pleine élection présidentielle. Nous sommes entre les deux tours. L’un des candidats, qui a le vent en poupe, si l’on en croit les sondages et les résultats du premier tour, fameux depuis quelques années pour son activisme débridé à la tête du ministère de l’Intérieur, célèbre aussi pour ses petites phrases assassines, notamment pour les jeunes des banlieues défavorisées et tous les anomaliques du système capitaliste qui laisse inévitablement beaucoup d’exclus sur le bord du chemin, n’a de cesse de proposer des mesures préventives visant à faire dépister par tous les acteurs sociaux, visant à traquer toutes les anomalies comportementales dès le plus jeune âge – les bébés sont eux-mêmes concernés – pour parer à la délinquance à venir. L’ordre doit être maintenu dans nos sociétés. Cet éminent chef de parti politique, dont l’enflure narcissisme n’est plus un secret pour personne, aime se montrer et parle alors beaucoup. Il ne peut s’en empêcher. Il a une pulsion comme tout le monde. C’est ainsi qu’il y a peu de temps, s’entretenant avec le philosophe Michel Onfray, notre fougueux politicien a livré sa croyance démesurée en l’inné, en la génétique. On s’en doutait un peu au vu de son fameux plan sur la prévention de la délinquance, mais il a confirmé. Je ne peux m’empêcher, excusez-moi, de vous lire l’extrait en question, de cet interview qu’il a donné à un philosophe. C’est paru dans Psychologie Magazine, début avril 2007. Alors voilà ce que dit Nicolas Sarkozy – excusez-moi, je l’ai nommé – (rires) :« Je me suis rendu récemment à la prison pour femmes de Rennes. – Je ne sais pas à quel propos il parlait de ça. – J’ai demandé à rencontrer une détenue qui purgeait une lourde peine. Cette femme-là m’a parue tout à fait normale. Si on lui avait dit dans sa jeunesse qu’un jour elle tuerait son mari, elle aurait protesté : « Mais ça va pas, non ? », et pourtant elle l’a fait.
(Alors, Michel Onfray) :
- Qu’en concluez-vous ?
- Que l’être humain peut être dangereux. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons tant besoin de la culture, de la civilisation – et j’ajouterai, de l’ordre public. Il n’y a pas d’un côté des individus dangereux et, de l’autre, des innocents. Non, chaque homme est en lui-même porteur de beaucoup d’innocence et de danger.(Jusque-là, bon, on peut supporter. Alors Michel Onfray) :
- Je ne suis pas rousseauiste, et ne soutiendrai pas que l’homme est naturellement bon. À mon sens, on ne naît ni bon, ni mauvais. On le devient, car ce sont les circonstances qui fabriquent l’homme. Nicolas :
- Mais que faites-vous de nos choix, de la liberté de chacun ? Onfray, le philosophe :
- Je ne leur donnerais pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n’avez pas choisi votre sexualité, parmi plusieurs formules. Par exemple, un pédophile non plus, il n’a pas décidé un bon matin, parmi toutes les orientations sexuelles possibles, d’être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement. Par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Nicolas Sarkozy :
- Je ne suis pas d’accord avec vous. J’inclinerais pour ma part à penser qu’on naît pédophile. Et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions pas soigner cette pathologie. Il y a 1200, 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année. Ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés, mais parce que génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense. »
C’est plutôt édifiant… et dangereux. Le « tout génétique », je veux dire le dépistage dès la naissance vire quand même à ce qu’on peut appeler un certain eugénisme.Il existe effectivement des tableaux psychiatriques où le risque d’autolyse est important. Nous savons pertinemment qu’un mélancolique en proie jusqu’à la torture morale à son indignité de vivre veut – il veut, vraiment, – et peut donc se donner impitoyablement la mort ; qu’un psychotique halluciné sous l’emprise du commandement impitoyable de ses voix peut s’ôter la vie… Nous le savons et il s’agit de faire ce qu’il convient au cas par cas. La psychanalyse n’est pas contre les médicaments. Ici, hospitalisation et médication adaptée s’imposent, dans l’urgence parfois – souvent, même, il ne faut pas attendre – de même qu’un suivi sérieux à l’issue de l’hospitalisation. Le déclin de la clinique psychiatrique est très inquiétant pour les temps à venir. Le « tous déprimés », le « tous bipolaires » est dangereux. Il ne faut pas oublier qu'à partir de l’homme fou, on sait ce qu’est un homme pas fou. Et mélanger les fous et les autres nous rend tous malades. C’est l’exception qui confirme la règle. Et je trouve vraiment que la psychiatrie, le DSM en particulier… – vous vous apercevez que c'est quelque chose que je n’aime pas – a fait totalement disparaître l’entité clinique de psychose, après avoir fait disparaître en premier lieu les entités cliniques de névrose. Là, elle s’en prenait évidemment à la psychanalyse, mais en faisant disparaître la psychose, elle nous rend tous malades. Tous déprimés, à chacun son médicament. C’est assez terrible, et ce qui explique d’ailleurs ce dont je parlais juste avant, que la plupart des malades mentaux actuellement ne sont pas reconnus comme des malades mentaux et se retrouvent en prison, par exemple. C’est un phénomène, je pense, qui existe dans tous nos pays civilisés. Soit-disant civilisés.
Et la psychanalyse…L’une des grandes découvertes de la psychanalyse, depuis Freud, c’est que les pulsions freudiennes que Lacan finira par unifier sous le terme de « pulsion de mort », puis d’épingler sous le terme de « jouissance » travaillent à notre destruction.Vivre, c’est, pour tout un chacun, compliqué et douloureux. La pulsion ne vise pas à donner aux hommes, ces corps parlants, du bien-être. Oui, à l’occasion, un petit plaisir à peine apparu, déjà disparu, mais elle travaille surtout à assurer la jouissance du symptôme, qui est ce dont on se plaint ; plutôt, en somme, de l’ordre du désagrément jusqu’à parfois la douleur d’exister. Ce masochisme fondamental profondément humain, cette haine de soi, liée à la pulsion de mort, est tout à fait structurale. Bien difficile, du coup, d’aimer son prochain si c’est comme soi-même. Il y a toujours une tromperie dans l’idée hédoniste du bien-être et du plaisir, idéal du monde. Qui peut encore croire qu’il suffit d’avoir ce que l’on veut pour être bien ? Tous nos gadgets n’y changent rien…En naissant, l’homme, toujours prématuré et déjà en détresse, se retrouve confronté à un étrange choix. Utilisons un des exemples de Lacan, celui de « la bourse ou la vie ». Ainsi, pour rester en vie, il doit se séparer de la bourse, perdre une part de lui-même. La vie se retrouve écornée et la mort s’inscrit d’emblée. Il perd dans ce processus humanisant, puisqu’il le fait entrer dans le monde symbolique des mortels, quelque chose du processus vital initial (en analyse, c’est ce que l’on nomme castration, mortification symbolique, manque-à-être, manque-à-jouir), tous ces effets d’écornage de la vie qui sont là à jamais, tant que dure sa vie, et qu’il va tenter de retrouver. Il va tenter de retrouver cette petite part perdue, qu’il a perdue pour vivre. La bourse ou la vie, je trouve que ça indique bien. Si vous choisissez la bourse, vous perdez la vie, et si vous choisissez la vie, vous perdez la bourse. Ça a beaucoup de conséquences, ça. Alors qu’il va essayer de tenter de retrouver, en vain, bien sûr. Il doit sa vie à ce que l’objet mythique, la bourse en question, soit perdue à jamais. Face à cette perte initiale, il se trouvera un complément d’être et d’avoir dans l’élection d’un objet prélevé sur le corps, objet de la Demande de l’Autre, de l’Autre maternel, et objet cause de son désir.
Et c’est ce qu’on retrouve chez Freud comme l’objet de la pulsion. Dans la série des objets a inventés par Lacan, vous avez le sein, l’excrément, le phallus, le regard et la voix. La vie du sujet dans son rapport à l’Autre, c’est-à-dire au monde, se retrouve ainsi cadré, régulé par le biais de ce petit objet a, grâce à ce qu’on appelle le fantasme S ? a.Mais notre corps, au niveau de certaines zones dites érogènes, d’où sont chus justement ces objets a, va garder des zones d’intense activité pulsionnelle, activité qui s’autoalimente puisqu’elle se satisfait de son activité même, sans objet privilégié. Lacan donne l’exemple d’une bouche qui s’embrasserait elle-même. Ce sont des zones de non-droit où le symbolique peine à se faire entendre. Quand quelqu’un vous dit « Je ne peux pas m’empêcher de… » ou « C’est plus fort que moi… », ça a tout à fait à voir avec la pulsion.Il est des sujets pour qui tout ce qui sera mis en place, de manière préventive ou coercitive, pour les protéger d’eux-mêmes, sera vain. Les psychiatres savent cela. Ces sujets très déterminés finiront, quoi que vous leur proposiez, par donner rendez-vous à la mort et elle sera à l’heure. Chaque soignant, fût-il des plus éclairés, ou chacun, comme le disait Lorraine Fortin en introduction, éprouve un jour ou l’autre cette expérience cruelle, cela va sans dire. C’est aussi la limite des pouvoirs de la parole qu’offre la psychanalyse. De nombreuses questions se posent : Jusqu’où peut-on obliger quelqu’un à vivre ? Et à quel titre le fait-on ? Où commence l’acharnement thérapeutique ? A-t-on le droit de laisser se suicider quelqu’un, voire de faciliter la mort de celui qui la désire ? Qui peut décider d’euthanasier un autre ? Face à ces problèmes éthiques qui touchent au rapport le plus intime que chacun entretient avec la mort et la vie, la plupart de nos sociétés tardent, non sans raison, je crois, du fait des possibilités de dérive, à légiférer. Chacun se voit donc renvoyé à sa responsabilité.
Ce fut le cas pour l’une de mes patientes, une femme belle et brillante, infirmière dans un hôpital parisien, dans un service de psychiatrie, dont la vie semblait se dérouler plutôt normalement. Mariée peu de temps au père de ses jumeaux, puis remariée à un médecin qui l’aimait, cette femme menait une existence agréable. Jusqu’au jour où sa mère, pour laquelle elle éprouvait un fort attachement, en proie depuis de longs mois aux douleurs intolérables d’un cancer osseux, la supplia d’abréger ses souffrances. L’une de ses sœurs finit par la convaincre. Elle fit ce qu’il fallait, rajoutant des opiacés dans la perfusion et veillant sa mère seule jusqu’à son dernier souffle.C’est pendant l’enterrement qu’elle sentit – l’enterrement de sa maman – qu’elle sentit la vie se retirer de son corps et que s’installa dans sa tête une petite ritournelle idiote et incessante empêchant toute activité. Je la rencontrai trois ans après. Elle vint me voir, adressée par son psychiatre, pour demander une psychanalyse. C’était, disait-elle, sa dernière chance de s’en sortir, même si elle n’y croyait pas. Elle avait tout essayé pour retrouver le goût de la vie : les médicaments (antidépresseurs et neuroleptiques) les séjours en clinique, les cures de sommeil, les tentatives de suicide et même les injections d’opiacés qu’elle se faisait quotidiennement, grâce aux ordonnances dérobées à son mari médecin qui fermait les yeux. Elle passait ses journées, engoncée dans une vieille robe de chambre, assise dans un fauteuil à ne rien faire comme sa mère les derniers mois avant sa mort. Son principal souci était son mari qui n’allait pas bien et qui, je l’appris quelques mois plus tard, lui proposait à ce moment-là de se suicider avec elle. Je finis en sa présence par le recevoir ; il était mal en point. Je l’adressai à un confrère psychanalyste qui le suivit quelque temps. Il alla mieux. Elle était toujours vide. La vie n’avait plus de sens. Elle restait une coquille vide, que rien ne parvenait à animer, et elle avait la certitude que rien ne changerait. Son psychiatre – efficace – lui proposait d’entrer en clinique pour une série d’électrochocs. Vous savez que les électrochocs peuvent être efficaces quand les antidépresseurs n’apportent aucune amélioration. Elle hésitait.Identifiée à sa mère malade, elle fit alors ce qu’elle avait souvent évoqué lors de nos entretiens hebdomadaires : elle se suicida. Elle s’euthanasia, plus exactement. Son mari m’apprit au téléphone avec beaucoup de délicatesse, je trouve, la nouvelle de sa mort, dans une chambre d’hôtel, par intoxication. Elle était morte par intoxication médicamenteuse. Je ne fus pas le moins du monde étonnée. Je n’en sus pas plus. Car je lui avais donné rendez-vous, à son mari, et il ne vint pas. Je respectai son silence. Il me revint, quelques jours après cette nouvelle, alors que, lors de sa dernière séance quelques jours auparavant, sur le pas de la porte, nous allions nous quitter, elle m’avait regardé longuement en souriant et m’avait remercié de l’avoir soulagée en aidant son mari. La boucle était bouclée pour elle et au fond, l’enjeu de son analyse, c’était pour elle ceci : qu’il puisse vivre sans elle pour qu’enfin, elle puisse mourir seule comme elle le voulait. La logique implacable de cette cure ne s’est dégagée que dans l’après-coup pour moi.Aussi curieux que cela puisse peut-être vous paraître, je considère que même dans ce cas, la psychanalyse n’a pas failli à sa tâche. Car sa pratique ne prétend nullement vouloir le bien du sujet qui s’adresse à elle, contrairement à la psychiatrie et à bon nombre de psychothérapies. C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’elle s’adressa à la psychanalyse, ayant fait le tour du reste. L’acte suicidaire, un acte limiteLa psychanalyse ne croit pas au bonheur, il est déjà là (le sujet de l’inconscient, qui n’est pas l’individu, est toujours heureux dans la répétition) ; la psychanalyse ne prêche nullement l’espoir. Bien au contraire, l’analyse va contre l’espoir en ce qui concerne l’avenir. L’avenir, c’est un fantasme. La psychanalyse prétend que c’est ici et maintenant que le désir doit se jouer.Ainsi, dans son texte Télévision, Lacan répond à quelques questions, notamment page 66, à la question « Que m’est-il permis d’espérer ? ». Et voici ce qu’il répond :« Sachez seulement que j’ai vu plusieurs fois l’espérance, ce qu’on appelle : les lendemains qui chantent, mener les gens que j’estimais (…) au suicide tout simplement. » Il continue : « Pourquoi pas ? Le suicide est le seul acte qui puisse réussir sans ratage. Si personne n’en sait rien, c’est qu’il procède du parti-pris de ne rien savoir ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Seul l’être humain peut imaginer sa mort et vouloir se la donner. C’est ce qui le différencie de l’animal. Cela participe d’une décision, de vouloir mourir, et d’y parvenir. Mais si le sujet meurt, il ne pourra rien en dire et s’il en réchappe, il aura raté sa mort. La psychanalyse, fort heureusement a bien plutôt à faire à l’acte manqué. Elle vise à traiter au cas par cas et dans le plus grand respect de la dignité, ces sujets de la parole et du langage que leur destin amène aux bords du suicide. Loin de toute visée de suggestion ou d’empêchement, la psychanalyse tente de redonner au sujet un accès à son désir. Ici, dans le cas de la patiente dont je vous ai parlé, ce fut un accès au désir de mourir, un désir très décidé ; mais dans la grande majorité des cas, c’est à un profond désir de vivre que la psychanalyse, heureusement, donne accès. Le psychanalyste est confronté à des demandes parfois suscitées par des idées suicidaires, ou par une tentative de suicide, susceptible d’inquiéter le sujet, qui ne sait pas pourquoi il a commis l’acte, ou pourquoi il y pense.Dans le cas d’une tentative de suicide, c’est à prendre particulièrement au sérieux, même si le patient tente rapidement de le banaliser, sous l’aspect de l’appel à l’aide. Non, il n’est jamais anodin de vouloir attenter à ses jours d’une manière directe, comme lorsqu’on fait une tentative de suicide, ou indirecte, d’ailleurs. Toute une série de comportements sont particulièrement dangereux pour la vie, ça n’est un secret pour personne. Dans ce registre, l’alcoolisme, les toxicomanies, les automutilations, l’anorexie, voire même certaines boulimies… ne sont pas en reste, mais peuvent néanmoins protéger certains sujets, un temps, de l’acte suicidaire franc. Ainsi par exemple, avant de proposer à quelqu’un qui vous le demande pourtant avec insistance – il vient parfois même vous voir pour cette raison – de cesser de boire ou de se droguer, il s’agira d’en savoir beaucoup plus sur ce qui le pousse à s’intoxiquer.Pour le psychanalyste, qui croit à l’inconscient, le symptôme a toujours une causalité psychique. Il n’est pas là pour rien. Il veut en effet dire quelque chose de particulier sur le sujet qui vient vous parler et s’en plaindre. Le symptôme, ça peut vouloir dire quelque chose si quelqu’un est là exprès pour l’entendre et à l’occasion le traduire, c’est-à-dire l’interpréter dans la langue structurale du sujet – et pas dans la langue de la société. La psychanalyse propose que le sujet se voie restituer avec tact, et au moment qui convient, la responsabilité de son acte pour qu’il se le rapproprie, mais aussi qu’il se voie restituer la part de responsabilité qui lui incombe dans le désordre du monde dont il se plaint et qui l’a amené à vouloir en finir avec la vie. Ce savoir-là est ce qui peut redonner à un sujet le goût de vivre. Ceci doit se faire bien sûr très différemment qu’on soit dans la psychose ou qu’on soit dans la névrose.Ce n’est sûrement pas avec la visée comportementaliste des troubles du DSM, qu’il convient d’éradiquer à coup de pilules et d’exercices adaptés, que quelque chose de la jouissance symptomatique du sujet pourra s’entendre. Nous serons alors tous malades et donc tous irresponsables ? Ça semble être la pente proposée par nos gouvernants.Pour le psychanalyste, il n’existe pas de sujet sans symptôme c’est-à-dire pas de sujet dont le corps ne soit en prise avec la jouissance pulsionnelle, puisque pour l’être parlant, c’est le prix à payer pour supporter la vie.
La tentative de suicide de X ne sera donc jamais pour nous celle d’Y. L’acte, le passage à l’acte dans les différentes structures Lacan s’est beaucoup intéressé à l’acte. Il nous a d’ailleurs laissé tout un séminaire qui s’appelle L’acte analytique. Un acte, c’est pour lui, c’est pour nous très différent d’une action. Dans la vie, nous nous agitons beaucoup, mais nous actons peu. Car un acte comporte toujours un franchissement, une transgression, qui fait que le sujet qui l’a accompli n’est plus le même après qu’avant. Un acte vous change. La patiente que j’évoquais tout à l’heure avait euthanasié sa mère. Voilà un acte pour le moins transgressif. C’est cet acte qui semble l’avoir fait basculer de la vie qu’elle menait jusqu’alors, apparemment sans trop de difficulté, dans cet état de non-vie mélancolique, de mort subjective, à la petite ritournelle près qu’elle avait en permanence dans la tête et qui l’occupait complètement ; elle ne pouvait rien faire d’autre, pas même lire.L’acte fait changer celui que vous étiez avant. Nous parlons, dans le champ psychanalytique, de mutation subjective. L’après-coup d’un passage à l’acte peut donc être un moment propice à saisir pour sortir des sujets de leur impasse existentielle. Toujours, face à l’intention ou à la tentative suicidaire, il convient d’essayer de faire un diagnostic de structure, ce qui n’est pas toujours simple bien sûr. Le récit et les circonstances conjoncturelles du passage à l’acte lui-même peuvent en dire long. Dans la psychose, ils sont parfois des équivalents hallucinatoires. Cela nécessite du temps et un repérage clinique soigneux, car savoir si l’on est dans un registre ou dans l’autre, névrotique ou psychotique, reste tout à fait essentiel pour la suite.Dès « Deuil et Mélancolie », écrit en 1895, mais remanié avant sa parution en 1917 – donc ça fait quand même 90 ans que nous avons à notre disposition cet article, – Freud a mis pour nous en tension le travail du deuil normal, disons du névrosé, et la mélancolie. Ce petit texte fourmille d’indications cliniques essentielles…Ainsi, – j’en donne quelques-unes, mais c’est vraiment très précieux pour savoir, quand on a affaire à quelqu’un qui se présente comme déprimé, si c’est quelqu’un qui est dans un deuil névrotique ou si c’est quelqu’un qui est dans une mélancolie, dont vous savez effectivement que le risque suicidaire est très grand. C’est une des rares urgences psychiatriques, la mélancolie. – Alors, la honte…ainsi, si la honte est du côté du névrosé, l’indignité s’affiche, elle, sans honte du côté du mélancolique. Donc, d’un côté la honte du névrosé, de l’autre côté l’indignité. Indigne de vivre, le mélancolique va vous le dire, vous le redire, vous le déplier – si vous l’écoutez, évidemment. Si la perte de l’objet est effective et consciente pour le sujet névrosé, –le sujet névrosé sait de quoi il s’est séparé, la séparation d’avec un compagnon par exemple – par contre, elle peut ne pas être consciente pour le psychotique mélancolique dont le moi s’identifie à l’objet. Il va donc chercher à se perdre – au lieu de perdre son objet, il va se perdre, lui – puisqu’il est identifié narcissiquement à cet objet. Ses autocritiques, son auto-jugement impitoyable sont alors le produit du retour de la haine envers l'objet qui l’a laissé choir. Mais comme il s’agit de son moi, cela peut aller jusqu’au meurtre de soi, et parfois de ceux qu’il aime dans son entourage. Car le mélancolique n’est pas seulement dangereux pour son corps propre, il peut l’être aussi pour son entourage.
Il s’agit de ce que l’on appelle le suicide altruiste – en France, c’est comme ça, – qui émaille régulièrement les faits-divers de nos quotidiens. J’ai eu l’occasion de rencontrer à l’hôpital psychiatrique, où la justice l’avait internée, une jeune femme qui, en l’absence de son mari, dans un raptus mélancolique, avait attenté à ses jours, ainsi qu’à la vie de ses deux filles. L’une était morte. L’autre avait fort heureusement survécu. Elle était déprimée depuis quelques mois, une dépression d’allure banale, si l’on en croit son mari et son médecin généraliste, jusqu’aux jours précédant le drame, où elle s’était montrée inquiète pour ses filles, craignant qu’il ne leur arrive un malheur.J’ai eu beaucoup d’entretiens avec cette femme, après son passage à l’acte, sans antécédents particuliers, si ce n’est une difficulté, tout à fait repérable, à se séparer de ses objets d’amour. Que s’était-il passé pour que cette mère aimante, cette épouse attachante en arrive à ce point ? Deux fois rien, pourrions-nous dire, et pourtant !Pour ce sujet, qui pensait qu’une fille ne peut pas vivre sans sa mère, l’accès mélancolique se déclencha à la suite de l’interruption, durant quelques semaines, de la correspondance régulière qu’elle entretenait avec sa famille restée dans un pays lointain. Le courrier, simplement, s’était fait plus rare… Voilà, mes chers amis, à quoi peut tenir le goût de vivre, voire le sens de la vie d’un sujet ! À une lettre !Seule la clinique psychanalytique, qui pose l’existence de l’inconscient, que nous a léguée Freud et Lacan, permet un repérage sérieux de ce qu’il en est du sens de la vie pour un sujet. Car la vie, que notre corps ne fait que supporter, le sujet de l’inconscient, effet du langage sur le corps, ne fait que lui donner un sens particulier, singulier pour chacun, sens dont il jouit (c’est pour ça que Lacan fait le jeu de mots « joui-sens », c’est le sens joui) dans le symptôme. Ouir – écouter – ce sens nécessite la psychanalyse, nécessite un enseignement de la psychanalyse, nécessite une clinique analytique. Le psychanalyste n’est pas un religieux, au sens où il ne prêche ni bons sentiments, ni direction de conscience. Ce n’est pas non plus un médecin, qui veut sauver son congénère. Non, le psychanalyste est celui qui sait que les bons sentiments sont susceptibles de mener au pire comme nous le constatons, hélas, actuellement, avec le regain de l’eugénisme et la ségrégation politique de l’anomalie que Freud et Lacan ont vus venir. Il prophétisait, Freud, dans Malaise dans la civilisation, il prophétisait tout à fait cela. Au quotidien, notre pratique du un par un – pratique analytique, qui nous empêche d’ailleurs de faire des statistiques – tente de s’opposer à ce mouvement pour redonner à chacun la possibilité d’être acteur de sa propre existence. (Applaudissements)
Échanges avec la salle
Pierre Lafrenière : On va passer à la période de questions.
Patricia Johansson-Rosen : C’est un sujet difficile !
Pierre Lafrenière : Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la fonction de la lettre, de ces lettres, que recevait cette femme qui a fait un passage à l’acte ?
P. J.-R. : Mais ça donnait un sens à sa vie, loin de sa famille. Elle venait d’Extrême-Orient. J’ai pu repérer que déjà, lorsqu’elle avait rencontré son mari là-bas, dans son pays natal, et quand son mari était revenu en France, il y avait eu un petit problème de courrier, et elle avait développé un syndrome dépressif qui n’avait pas pris une tonalité mélancolique. C’est quelqu’un que j’ai beaucoup vu, j’ai même fait ma thèse sur ce sujet, sur ce cas, et on ne trouvait absolument pas d’événement important, au sens où nous l’entendons. Je veux dire, un névrosé aurait certainement pu faire autrement. Chez elle, visiblement, dès qu’elle n’était plus liée à sa mère, ne serait-ce que par un courrier régulier, au fond la vie n’avait plus de sens parce qu’une fille ne pouvait pas vivre sans sa mère. Et on voit que dans son passage à l’acte, puisqu’elle a essayé de tuer ses deux filles et bien sûr elle a tenté de se suicider, elle a emmené ses filles dans la mort, elle ne pouvait pas se séparer. Ou elles mouraient toutes, ou elles restaient toutes en vie. Mais au moment où ça s’est produit, il n’y avait plus qu’à mourir, la vie n’avait plus de sens, et je suis convaincue que ç’a été le déclenchement de sa mélancolie. Il faut vraiment interroger de très près les sujets, c’était un peu tard, c’était après. Mais c’est toujours très enseignant de voir, effectivement, à quoi peut tenir le sens, le goût de la vie de quelqu’un. Le goût que vous avez de la vie ne ressemble pas à celui de la personne que vous entendez. Un petit événement peut provoquer une grande catastrophe, et c’est en général dans le lien à l’autre – lien fragile, dans la psychose – , et au fond, la lettre représentait sa mère pour elle.Une participante : Vous parlez du lien à l’autre. Peut-on aussi parler du lien à soi ?
P. J.-R. : Mais soi, c’est l’autre. Puisque de toutes façons on ne peut se reconnaître qu’en s’identifiant. Il n’y a pas d’autre moyen. Donc, je est un autre. C’est-à-dire que l’enfant, – c’est le fameux stade du miroir de Lacan – l’enfant, c’est au travers de son image, et l’image est autre. C’est le grand problème de l’humain, il passe toujours... enfin dans le meilleur des cas, parce que par exemple, dans la psychose, on voit bien que les identifications, quand elles existent, sont extrêmement fragiles et qu’il faut ce qu’on appelle des suppléances pour que ça tienne. La lettre, dans ce cas, est une suppléance, il faut ça pour suppléer à l’absence de la mère. Chez le névrosé, l’objet petit a est une suppléance. Mais c’est quelque chose qui est logé en l’autre. Tandis que dans la psychose, par exemple les voix de l’hallucination sont des objets petit a que le psychotique a avec lui. Qu’est-ce qu’on est, enfin ? On est plutôt le symptôme. Lacan considère que c’est le symptôme qui dit quelque chose de l’être. C’est-à-dire que l’être, c’est la façon dont on jouit. Ça se réduit à ça.
Et tout ce qu’on peut reconnaître est de l'ordre de quelque chose d’imaginaire et en passe par l’image.
Monique Lévesque : Tout à l’heure, lorsque vous parliez de l’infirmière, vous disiez qu’il y avait une ritournelle qui revenait en elle. Quel était son contenu ? Est-ce qu’elle vous en a parlé ou pas vraiment ?
P. J.-R. : J’ai essayé, bien sûr, ça m’a tellement intriguée que j’ai voulu savoir ce que c’était, sauf que quand elle venait me voir, ce n’était plus là, ça s’arrêtait, donc elle ne pouvait pas en parler. Je veux dire, c’était perdu.
Donc c’était vraiment très envahissant, elle passait ses journées occupée par la petite ritournelle qui s’interrompait quand elle parlait. Pas seulement dans ses séances avec moi, mais quand elle parlait avec ses enfants, son mari. Mais une fois que la petite ritournelle n'était plus là, elle ne pouvait rien en dire. Ce qu’elle m’a simplement dit, c’est que c’était stupide. « Petite ritournelle stupide ». Donc, je n’ai rien pu savoir, même ça, si vous voulez, c’était coupé. Ce n’était pas accessible. On ne pouvait s’accrocher à rien, et la seule chose qui la tenait dans les séances, c’était d’évoquer, effectivement, son désir de mourir, et ce qu’elle pourrait faire. Et je pense que probablement, j’étais la seule personne à qui elle pouvait dire ça, parce que son mari n’aurait pas supporté. Quoique lui-même ait eu envie de se suicider avec elle. Je pense que c’était un homme psychotique.
Monique Lévesque : Est-ce que vous iriez jusqu’à dire que le fait qu’il y a eu passage à l’acte, c’était une façon d'obtenir que cette ritournelle tombe, cesse, et que quelque part, l’acte était la façon d’interrompre ce qui l’envahissait au point de la désubjectiver ?
P. J.-R. : Je crois que c’est la seule chose dont elle se plaignait, la ritournelle, parce que la ritournelle l’empêchait de faire quoi que ce soit. Mais par exemple, elle n’a pas pu me dire grand-chose de l’euthanasie, de ce qui s’était passé pour elle. C’était complètement désaffecté, il n’y avait pas de reproches, il n’y avait pas de honte, c’était vraiment un désert. Un désert. Et au fond, peut-être que la petite ritournelle, c’était la seule chose un petit peu vivante. Mais tellement stupide. C’était une petite flamme, comme ça, dans le noir. Mais à laquelle elle n’avait même pas accès, au point de pas pouvoir en parler, ne rien pouvoir accrocher à ça. Moi, j’aurais bien aimé qu’il y ait des paroles. Qu’il reste quelque chose, enfin, qu’on puisse s’accrocher, qu’on puisse construire… Rien, rien. Et ce qui est étonnant, quand même, j’ai rarement vu ça, c’est qu'aucun traitement n’a produit d'effet. Elle a été suivie pendant trois ans, aucun traitement, tous les antidépresseurs, des plus anciens aux plus récents ont été essayés, psychothérapie, cure de sommeil… la psychiatrie avait utilisé les grands moyens… il restait les électrochocs et ça… Elle était infirmière en psychiatrie quand même. Donc, les électrochocs, elle en avait beaucoup vu et elle ne voulait pas être un légume. Elle se sentait déjà un légume et je pense que peut-être elle avait peur de se séparer de sa petite, de sa petite lueur, petite chose vivante, stupide. Stupide existence, mais quand même. J’ai l’impression que c’était la seule chose un peu vivante chez elle. J’ai rarement – fort heureusement – dans ma pratique, j’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi déserté. En même temps, on peut considérer que c’était certainement déserté par le symbolique, mais rempli de jouissance. Je la voyais régulièrement, mais fort peu de temps parce que j’ai essayé de couper ça. Et je crois véritablement, en me souvenant de ses derniers mots quand elle a pris congé de moi, et je l’avais trouvée apaisée, donc je pense qu’elle avait déjà décidé. Je pense que son principal souci… elle m’avait bien dit qu’elle n’y croyait pas. Mais elle avait peur pour son mari. Et donc, au fond, elle s’est arrangée pour que je le voie, je ne fais pas ça souvent, ce n’est pas très orthodoxe, et puis que je l’adresse. Elle a attendu qu’il aille mieux, c’est-à-dire qu’il pouvait vivre sans elle, chose qu’elle ne pouvait pas faire au fond, elle, sans sa mère, et elle a rejoint sa mère dans la mort. Quelque chose comme ça. Alors évidemment, si j’avais su, peut-être que je n’aurais pas vu le mari… mais le problème c’est qu’ils se seraient suicidés tous les deux. Enfin, c’est quand j’ai entendu ça que je me suis dit : il faut que je le reçoive avec elle. Je pense que c’était le mari qui l’avait poussée à faire une analyse. Il y croyait, lui, un peu plus. Une participante : Une tentative de suicide : qu’est-ce qui fait qu’une personne, par exemple, va s’intoxiquer aux médicaments, puis va ensuite tout de suite appeler quelqu’un, comme changer d’idée ? Est-ce la pulsion de vie qui reprend le dessus, est-ce par rapport à l’inconnu ?
P. J.-R. : Lacan nous a simplifié le travail. Pour Lacan, pulsion de vie et pulsion de mort, ça s’appelle la jouissance. C’est-à-dire que dans la jouissance, il y a une part de douleur consciente, de gêne, de tension… Même la tension, c’est de l’ordre du désagréable. Et puis il y a une part de plaisir, mais qui est un plaisir inconscient. C’est-à-dire que le sujet, évidemment, ne sait pas qu’il se satisfait de quelque chose qui fait mal. C’est pour ça que je vais parler de masochisme, de masochisme primordial. Ceci est parfaitement décrit chez Freud.
Je n’ai pas bien entendu, mais vous parlez de gens qui prennent, par exemple des médicaments et qui appellent quelqu’un à l’aide, c’est ça ? Je pense que ces personnes ne sont pas dans la même problématique. Par exemple la patiente dont j’ai parlé, qui voulait vraiment couper avec l’autre, dont le lien avec l’autre était un encombrement. Je veux dire, chez elle, c’était une délivrance, elle n’arrêtait pas de le dire.
Et je crois que chez les personnes plutôt névrosées – mais c’est à vérifier, ce n’est pas parce que quelqu’un appelle au secours qu’il est forcément névrosé, je crois que chaque cas est différent – je pense que le rapport à l’autre tient. Parfois le patient veut savoir s’il peut manquer à l’autre. Et on voit bien, d’ailleurs, certaines idées suicidaires de névrosés, qui imaginent, par exemple, leur enterrement : « Quand je serai mort, quel effet ça fera à ceux que je vais laisser ? » On voit bien, il y a un petit esprit de vengeance.
Ma patiente était très éthique parce qu’elle aurait pu parfaitement, vu l’état dans lequel elle était, se moquer totalement de son mari, de l’état de son mari. Et même vouloir l’entraîner avec elle dans la mort. Pas du tout. Alors ils avaient des fils, aussi, des grands fils, qu’elle ne pouvait pas faire mourir avec elle. Plus petits, peut-être ; peut-être que toute la famille… On voit ça de temps en temps dans les journaux : une mère qui se suicide avec ses enfants ou alors un père de famille qui tue toute la famille, ça existe en France, je pense que ça existe dans le monde entier. Je crois que ce sont des mélancolies, des épisodes mélancoliques avec des déclenchements brutaux. Et je crois qu’il est très très important de repérer les idées d’indignité, de péjoration de l’avenir, c’est extrêmement important. Pour éviter… s’il y a vraiment une prévention à faire, c’est du côté de la clinique, de savoir dans quel registre on est. Et de ne pas se contenter seulement du type de passage à l’acte. C’est-à-dire, il faut écouter les gens. Pas d’autre moyen. Un participant : La première question sur laquelle j’aurais aimé vous entendre : vous avez parlé un peu du rôle des religions à travers l’histoire, et j’aimerais connaître votre perception. Je ne connais pas bien la situation en France, mais celle du Québec, il y a eu beaucoup d’évacuation de tout l’aspect de la religion dans les dernières décennies. Et selon vous, est-ce que ça joue un rôle dans notre haut taux de suicide dans notre société ?
Ma deuxième interrogation sur laquelle j’aurais aimé vous entendre, c’est votre vision de la pulsion de mort et de l’inconscient dans les suicides pour des causes religieuses ou politiques ?
P. J.-R. : Aie ! (rires). Bon ! Moi je crois qu’on peut penser ce qu’on veut de la religion, je n’en pense pas forcément du bien, mais en tout cas, ça a proposé un type d’identification qui tenait. Et puis il y avait aussi l’idée, avec les exigences de la religion : on ne peut pas faire ce qu’on veut pour rester dans la communauté des chrétiens. Cela demande beaucoup, il faut se surveiller de près. Je pense que ça permettait des identifications qui tenaient la route. Je pense que dans notre monde, c’est difficile de s’identifier maintenant. À qui s’identifier ? Qui vous donne envie de vous identifier ? Il n’y a même plus de grands hommes politiques. (Rires) Non, mais c’est vrai. Et je pense que la religion a fait beaucoup de dégâts, mais en même temps, elle a donné l’idée à des générations et des générations d’appartenir à une communauté. C’était pas pareil d’être juif, d’être catholique, protestant ; on appartenait à une communauté, on était moins isolé et je pense que c’est peut-être le bienfait de la religion qui a beaucoup, beaucoup d’inconvénients par ailleurs. Mais je pense que notamment, c’est bien pourquoi il me semble que dans certaines psychoses, on voit des baptêmes… on voit que les gens essaient de retrouver un autre qui tient la route, un autre exigeant, qui leur donne des règles. On voit, en France en tout cas, beaucoup de psychotiques qui trouvent comme solution – on peut considérer que ce n’en est pas une – par exemple, de devenir islamistes. Alors je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas bien compris, généralement c’était des catholiques, et qui rentrent dans l’islam. Il y a beaucoup plus de règles... il y a la prière quatre fois par jour, il y a une rigueur que n’a plus, même quand elle existe encore, que n’a plus la religion catholique. Elle tient encore la route, il suffit d’entendre le Pape... mais en même temps, qui défend des valeurs… toutes les jouissances ne sont pas permises. Pour le Pape, on voit bien : pas de préservatifs, le mariage… toutes ces choses qui nous paraissent, quand même, d’un autre âge, complètement réactionnaires, et qui, semble-t-il, pour les gens en manque d’identification comme peuvent être les psychotiques, ont une valeur. Alors faut peut-être que le Pape reste en place pour nos patients psychotiques. Ça veut encore dire quelque chose… parce que dans la psychose, vous savez, c’est étonnant, moi j’ai eu des patients qui n’étaient pas du tout sûrs que demain le soleil allait se lever. C’est-à-dire que nous, on n'y réfléchit même pas ; on sait, quand le soleil se couche, que demain il va réapparaître. On est pris, on sait, on a toute confiance en le soleil. Eh bien eux, non. Donc effectivement, l’islam aussi, je pense parce que c’est exigeant, peut protéger certains sujets.Alors, votre deuxième question, c’était la pulsion de mort et les kamikazes, c’est ça ?
Le même participant : Oui.
P. J.-R. : Samson le premier, ça m’a fait rire, je n’avais jamais pensé à ça ! Vous connaissez l’histoire de Samson qui n’hésite pas à laisser sa peau pour tuer ses ennemis les Philistins en ébranlant le Temple… C’est un mystère, quand même. En tout cas, je ne connais pas suffisamment l’islam. Enfin, j’ai cru comprendre que quand même, pour les islamistes, me semble-t-il, ce que l’on dit – mais c’est à vérifier, ce n’est peut-être pas très sérieux ce que j’avance – la sexualité est débridée après la mort. C’est-à-dire qu’après la mort, comme le Prophète, vous pouvez avoir plusieurs femmes et il n'y a pas besoin de se marier… C’est très compliqué, l’islam, la sexualité des jeunes, il y a une rigueur, il faut en passer par le mariage. Vous pouvez avoir plusieurs femmes, mais quand même, il faut être marié avec chacune. Et il me semble que mourir, c’est pouvoir jouir très librement. Donc, c’est la pulsion de mort en plein ?
On ne voit pas trop comment ça pourrait s’arrêter, quel est le principe d’arrêt de cela. Je pense que dans l’islam, la sexualité est quand même très très codifiée, on ne plaisante pas. On ne peut pas coucher avec qui l'on veut hors des liens du mariage, c’est-à-dire que ça complique tout, faut bien le dire. Et il me semble qu'après c’est l’extase. Je ne conseille à personne… c’est sur terre que ça doit se passer ! Il y avait quelque chose comme ça dans la religion catholique. On est sur terre pour souffrir et ça ira mieux demain. J’ai l’impression que la religion protestante est plus souple… par rapport à cette question de la sexualité ; même sur le suicide, c’est moins serré, me semble-t-il. Par exemple, je crois que l’homosexualité est tout à fait autorisée. J’ai connu des pasteurs qui l’étaient, ça ne posait strictement aucun problème. Ce qui n’est pas le cas de la religion catholique, qui est une religion exigeante, mais alors faut-il croire pour se protéger ? Il y a d’autres inconvénients ! Mais enfin le névrosé obsessionnel, de toutes façons, il a sa petite religion. Ce qui est très enseignant pour savoir ce qu'est la pulsion de mort, c’est la névrose obsessionnelle. Là, j’ai beaucoup parlé de la mélancolie et de la fragilité du sens de la vie, mais il faut savoir que l’obsessionnel, son partenaire psychique, c’est la mort. La mort de l’autre, la rivalité, avoir la peau de l’autre, sinon celui-ci veut votre peau... il y a tout un jeu avec la mort qui est très présente. Si vous lisez « L’homme aux rats » de Freud, la mort est présente tout le temps. Mais c’est vrai, bien sûr, que les névrosés obsessionnels peuvent passer à l’acte, mais pas tant que ça, beaucoup moins que les mélancoliques. Donc névrose, psychose, vaudrait mieux avoir une petite boussole pour savoir où se situe chaque sujet que nous rencontrons. C’est important. Et vraiment, avec le DSM, je ne vois pas comment on peut s’y retrouver. D’abord, c’est très ennuyeux. Je m’inquiète pour la santé de gens qui l’utilisent, parce que c’est débilisant ce truc ! Fort heureusement, pendant mes études, j’ai échappé à ça, c’était encore la bonne vieille clinique classique, étoffée. Ce n’était pas à partir d’un trouble qu’on diagnostiquait. On parlait de névrose, de psychose, de perversion, on prenait l’histoire du sujet, on s’intéressait aussi à sa façon de dire les choses… Moi, c’est en psychiatrie que j’ai rencontré la psychanalyse, dans un service de psychiatrie que j’ai rencontré des psychanalystes. Parce que la psychanalyse, ce n’est pas uniquement en cabinet privé, une chose réservée à des gens aisés et riches, pas du tout ! La psychanalyse, elle était dans beaucoup d’hôpitaux psychiatriques et c’était la boussole de la clinique il y a vingt-cinq ans. Sauf que maintenant ça ne l’est plus, et que c’est une catastrophe : tous déprimés, tous sous antidépresseurs. Quand vous êtes psychotique, évidemment, vous vous mettez à délirer à pleins tuyaux sous antidépresseurs, parce que vous n'étiez pas fondamentalement déprimé, mais psychotique. C’est dramatique !
Je suis plutôt inquiète pour ça que pour l’augmentation des taux de suicide. Je trouve que l’urgence est de redonner à la clinique, à la folie, ses lettres de noblesse, parce qu’elles nous en apprennent vraiment très long sur ce qu’est l’homme. Parce qu’il y a une clinique épurée dans la psychose, en effet, les psychotiques ne sont pas empêchés. Nous les névrosés, on a du refoulement, on a des tas de choses qui nous empêchent. La psychose est une structure épurée de ce qu’est l’être humain.
D’ailleurs, j’ai essayé cette nuit – parce que le décalage horaire rend parfois les nuits difficiles – j’ai essayé de me souvenir qui disait qu’au fond on juge une nation à l’état de ses prisons et de ses hôpitaux psychiatriques. Ce sont deux critères fondamentaux pour savoir si on est aussi civilisé que ça. Je peux vous assurer qu’en France, ce n’est pas brillant. Mais je ne suis pas déprimée ! (rires) Névrosée, tout au plus.Comment fait-on alors, au Québec, pour se repérer ? Parce qu’il y a, comme partout, beaucoup de tentatives de suicide. C’est la première fois que je viens, donc je ne sais pas exactement quelles sont vos boussoles. Est-ce que le DSM est partout ? Est-ce que c’est très comportementaliste, les traitements aussi ?
Monique Lévesque : Bien, je peux peut-être tenter de vous répondre un tout petit peu…
P. J.-R. : Oh, volontiers !
Monique Lévesque : Enfin pour informer les gens, je vous dirai d’abord que j’avais fait un parcours à Laennec, à Paris, en tant qu’attachée de psychothérapie. À mon retour à Montréal, j’ai travaillé dans une urgence hospitalière, et c’était pour diminuer la fréquence des suicides. Donc on voyait les gens le temps d'une évaluation et d'un suivi court terme, et cela s’est fait pendant plusieurs années. Après six ou sept ans dans le milieu hospitalier, on a dit « Bien là, ça va bien, il y a moins de récidives alors on ferme le service. Maintenant il n'y a plus de problème, on a désengorgé les urgences, il y avait des civières dans les corridors avec des suicidaires, c’est encombrant, mais maintenant qu’il y a eu quelques années de suivi, on a moins de suicidaires sur les civières, donc on ferme le service de consultation suicidaire. » C’était dans une urgence hospitalière ici au Québec. Cela a duré de 1986 à 1993, et par la suite on a dit : « les gros cas iront en psychiatrie mais les autres, on va simplement faire un lavage d’estomac et puis après on les renvoie avec une petite tape dans le dos et puis ça devrait aller ».
Voilà. Ça, c’est un bref résumé.
P. J.-R. : En France, ça devient comme ça aussi. Laennec n’est certainement plus ce qu’il était ! Laennec est un hôpital Parisien.Lorraine Fortin : Même les programmes d’aide aux employés, ce que ça vise, c’est le retour de la personne le plus rapidement possible dans son milieu de travail. C’est à ça qu’on travaille.
P. J.-R. : Le retour à l’adaptation !
Je suis très, très étonnée que les psychiatres se soient laissés faire aussi facilement. En tout cas en France, il y avait une tradition humanitaire. Mais déjà, quand j’ai fait mes études à l’hôpital Sainte-Anne (hôpital psychiatrique à Paris), les vieux chefs de service étaient encore des gens qui s’intéressaient à ce dont je viens de vous parler, c’est-à-dire le sens de la vie, qui prenaient du temps pour discuter avec les patients. Et parmi nous, déjà, il y avait ceux qui s’intéressaient plutôt aux traitements chimiques et qui essayaient de discuter le moins possible avec les patients parce que ça les angoissait. La folie est angoissante. Et c’est angoissant pour tout le monde. Moi, j’ai choisi d’être psychiatre pour savoir ce qu’était la folie. Donc ça m’étonne tellement qu’on ait pu baisser les bras et ne pas résister plus.Une participante : Le changement a été initié par les psychiatres ici.
P. J.-R. : Oh, ça ne m’étonne pas !
La même participante : Ils voulaient faire de la désinstitutionnalisation.
P. J.-R. : Ça ne m’étonne pas, ils n’ont pas tous de bonnes idées ! L’âge d’or, quand vous entendez parler Lacan – quand vous le lisez, plus exactement, puisqu’on ne peut plus l’entendre – quand vous lisez Lacan et qu’il parle de ce qu’est un médecin, de ce qu’est un psychiatre, c’était quelqu’un… Ou lire Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, on voit bien que la folie est un repère dans la civilisation. La façon dont on traite ses fous, dont on les reconnaît, c’est extrêmement important pour tout un chacun et pour l’avenir d’une civilisation. Et là, ce ravalement, en France je ne l’ai pas vu venir... et pourtant je travaillais encore en psychiatrie, on avait des échelles d’évaluation… Alors là, entre le DSM-III, le DSM-IV, plus rien n’existe, tout est abrasé, tout simplement pour enrichir de grands laboratoires pharmaceutiques américains. On voit bien que c’est le médicament qui décide des entités, des troubles.
Jean-Paul Gilson : Donc le DSM-IV, ça n’est jamais qu’une ritournelle collective…P. J.-R. : Oui.Jean-Paul Gilson : …c’est la même que celle de votre patiente.
P. J.-R. : Absolument.
Jean-Paul Gilson : Et bien sûr, qui pousse tout droit vers un suicide collectif avec ces choses-là…
P.J.-R. : Mais la psychiatrie est morte. En France, ce qui se profile, c'est qu'il faudra faire des études beaucoup plus courtes pour pouvoir remplir ces petites fiches ! Et ce sera tout bénéfice ! On est même actuellement en train d’évoquer la possibilité que ce soient des non-médecins qui prescrivent, en France.
Jean-Paul Gilson : Faut quand même voir que le suicidaire est quelqu’un qui interroge ça, qui interroge le processus de signification comme personne d’autre. La sienne. Il faudrait peut-être voir les choses de ce côté-là. Il me semble qu'il faut promouvoir, au contraire, les questions qui sont posées par le suicide plutôt que d’essayer de les éviter.
P. J.-R. : Bien sûr, mais c’est comme ça pour tous les troubles, pour tous les symptômes. Le symptôme est une solution pour le sujet, il ne faut jamais oublier ça. C’est-à-dire qu’un délire, ça aide un sujet à vivre.
Jean-Paul Gilson : Faut voir que dans les écoles primaires, ici comme en France et comme ailleurs… on demande aux enfants de faire par exemple de l’analyse grammaticale. Et on leur met déjà d’avance des cases préinscrites dans lesquelles ils ont à inscrire des contenus qui sont déjà préinscrits eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui les barbarise et qui les éloigne de leur désir à eux de donner une signification à leur vie. C'est ça l'histoire. Ce ne sont pas seulement les psychiatres qui sont en cause.
P. J.-R. : Bien sûr, mais moi je me sens responsable parce que la folie, c’était l’affaire des psychiatres. Là, ils ont été en dessous de tout. Mais ils ne sont pas les seuls. Et je trouve que notre civilisation perd beaucoup. Peut-être faut-il en passer par là pour que quelque chose resurgisse ? Mais on est quand même dans l’ultra-libéralisme. Comme vous le dites des enfants, nous allons tous bientôt n'être que des exécutants. Pendant toute notre vie on remplira des petites cases pré-établies avec des contenus pré-établis... Alors est-ce que ce sera très calme, je ne sais pas… À votre avis ? Ça va faire les beaux jours de la psychanalyse parce que le sujet ne se laisse pas totalement prendre, il va inventer de nouveaux symptômes.
Pierre Lafrenière : Il y aura de nouveaux médicaments ! (rires)
P. J.-R. : Ah ! Absolument, absolument ! Mais ça va être la surenchère !
Fabienne Espaignol : Par rapport à ça, vous parliez de la mort et de la mort du sujet. Est-ce qu’on peut tuer le sujet ?
P. J.-R. : Il est indestructible.
Alors j’ai parlé à un moment donné de la mort du sujet, c’était dans la psychose. Dans la psychose, il peut y avoir une coupure radicale par rapport à l’autre, et une sorte d’autisme, enfin de bulle quand certains psychotiques se replient. J’avais un patient qui se réduisait, il était ce qu’il voyait, le point qu’il voyait sur le mur. Il n’y avait rien d’autre. La régression scopique, la régression spéculaire, et là, on peut parler de mort du sujet. Mais sinon, le sujet, c’est comme son désir, est indestructible. Et la pulsion aussi est indestructible, c’est-à-dire que ça non plus, on ne pourra jamais la faire taire. Elle pourra avoir, je pense, des expressions cataclysmiques, comme effectivement des bombes humaines. On n’arrivera pas à cadenasser l’espèce humaine. Ou alors je pense qu’elle ne se reproduira plus. Ce qui n’est pas le cas au Québec ! J’ai appris qu'au Québec, on naît plus actuellement.
Lorraine Fortin : C’est nouveau.
P. J.-R. : Avant ça, d’ailleurs, il n’y aura plus de planète, parce que l'humain en met un coup pour réduire son espace vital. Karen Harutyunyan : J'ai trois questions ou réflexions pour réfléchir avec vous.
La première concerne la fonction de la religion et l’islam avec les kamikazes. Vous l'avez évoquée de façon un peu généralisée. Je trouve que la tendance des gens qui, en étant au départ plutôt de religion catholique et qui se tournent vers l’islam, il s'agit là de l’image de soi tournée vers l’autre, dans une perspective identificatoire. Ce n’est pas la religion comme telle et la ritualisation qui est en question, mais plutôt cette image de soi-même insupportable et tournée…
P. J.-R. : Je parlais de psychotiques...Karen Harutyunyan : Oui, oui.
P. J.-R. : Je parlais de psychotiques très très malades qui ont trouvé un apaisement en devenant musulmans. J’ai connu une dizaine de cas de gens très très souffrants, que rien n’arrivait à arrêter, qui ne trouvaient pas de suppléance, et qui, à un moment donné, parce qu’ils avaient un ami, voilà, au gré d’une rencontre, ont trouvé ce moyen de se tempérer ; enfin quelque chose de leur jouissance s’est tempéré et ça marchait bien !
Alors ce qui veut dire que leur propre religion ne leur suffisait pas. Au fond, le curé ne fait plus ce qu’il faut pour qu’on le croie, pour qu’on puisse s’identifier, que le Christ n’est plus un personnage qui porte. Alors que pendant très longtemps, on avait des psychotiques dans les hôpitaux psychiatriques qui, quand vous arriviez, vous posaient les mains sur la tête, ils vous baptisaient. C’était une identification forte, l’identification au Christ. Ça c’est inversé, à un moment donné. Je suis allée à Jérusalem il y a quelques années, et pour être hébergés, on était dans un truc religieux, et il y avait des sœurs qui étaient en même temps des infirmières, et qui m’ont parlé du syndrome de Jérusalem. Et notamment, on s’est retrouvés dans ce séjour avec une jeune femme, délirante, mais comme c’est pas permis, et les sœurs avaient l’habitude de ça, elles lui donnaient de bons conseils, elles lui disaient à quelle heure il fallait aller au Saint-Sépulcre. J’étais très admirative, elles l’ont soutenue, elle n’a pas été rapatriée en urgence, et elle allait mieux au bout de quelques jours ! Elles savaient exactement ce qu’il fallait faire. J’étais très admirative. Sans neuroleptiques, sans rien. Chapeau ! Mais un savoir-faire, les mots qu’il fallait, en même temps gentilles, en même temps relativement fermes, enfin, ne laissant pas tout dire, et en même temps étant à l’écoute… Je me suis dit : certains psychiatres devraient en prendre de la graine ! (rires)Karen Harutyunyan : Deux choses. La première que j’ai observée : même dans la communauté des psychiatres, ils n’acceptent pas eux-mêmes le DSM-IV, par contre ils pensent que le DSM-III était beaucoup plus intéressant pour tout le monde, surtout pour les psychanalystes, c’était au moins le dernier bastion.
Et une autre chose : pendant les vingt derniers jours, j’ai participé à deux colloques. Un colloque des centres de crise et un autre qui était le Forum de psychiatrie de première ligne. Ce dernier était vraiment plutôt la comptabilisation des démarches du point de vue financier et économique de l’intervention psychiatrique, plutôt qu'une réflexion par rapport à ce qui se passe pour les gens. C’était vraiment un exemple de comment faire taire le sujet. Alors que lors du colloque des centres de crise, pendant notre présentation du centre de crise, qui travaille dans une perspective psychanalytique, personne n'a officiellement posé la question ouvertement après la présentation, mais il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir ensuite pour s’exprimer et me dire : « Vous êtes courageux ! ». C’était vraiment un phénomène très intéressant. Ça veut dire : en gardant officiellement la position générale concernant le refus du discours psychanalytique, chacun en soi-même se pose la question à sa façon. Mais comme si ce discours n'est pas vraiment permis officiellement et ouvertement, qu'il n'était pas permis d'y réfléchir.
P. J.-R. : Ça n’encourage pas la réflexion, cette uniformisation, cette globalisation. Et c’est pour ça que je pense que la psychanalyse doit dire quelque chose. Ça fait partie de sa mission. Déjà, Freud espérait amener la peste aux États-Unis. Il l’a amenée puis elle nous est revenue sous une autre forme. Je pense que la psychanalyse a à être subversive et à être extrêmement critique. Quand on voit que les libertés individuelles, le mode de jouissance veut être uniformisé. Après, il y a la loi, et ça c’est autre chose. Il y a la loi qui tranche, qui dit ce qui est bien, pas bien ; il y a la religion qui dit ce qui est bien, pas bien ; mais la psychanalyse revendique qu’il y ait du sujet, et on voit bien que tout le système actuel est fait pour évacuer le sujet. Il faut l’évacuer, sauf qu’on n’y parviendra pas, parce que c’est plus fort que tout, et c’est incoercible. Je ne sais pas comment ça va tourner. Vous avez une idée ? En tout cas, il faut être extrêmement vigilant.
Une participante : J’ai une idée, avec l’art ! Dans plusieurs institutions, ici, à Montréal, ils font faire de l'art. Aux Impatients par exemple, et les centres de femmes qui donnent des cours d’art, en croissance personnelle et tout ça… C’est très aidant. Et moi j’ai fait partie des amis de Jung. Ils tiennent des discours un petit peu plus encourageants que Freud. Je suis venue ici ce soir, je voulais faire la différence entre les deux, puis là je ne me sens pas comme quand je vais assister à une réunion des amis de Jung. Alors, il y a une solution quelque part, mais il faut que chacun la cherche.
P. J.-R. : Ah, voilà ! Voilà, voilà ! C’est le « un par un », la singularité de la solution. C’est ça qu’il faut. C’est ça ! Il n’y a pas un bonheur pour tout le monde, il y a des petites solutions pour chacun. Chacun doit se débrouiller et trouver ce qui lui convient, évidemment, dans la mesure... on a des normes sociales. Faut pas s’en laisser conter par ceux qui disent qu’une chose est bonne pour tout le monde, ce n’est pas vrai. Et la création, par exemple, a de l’avenir. Mais au fond, il faudrait que chacune de nos vies soit une création. Et c’en est une, d’ailleurs ; nous ne le savons pas, mais nous faisons, comme monsieur Jourdain, de la prose sans le savoir. Il n’y a pas deux vies qui se ressemblent. C’est ce qui fait toute notre richesse.
Pierre Lafrenière : On va terminer sur cette note pour ce soir. Donc demain, les rencontres du Pont Freudien se poursuivent avec les séminaires qui vont porter sur la question de la pulsion de mort. Rendez-vous à 9 h 30 demain à l’hôpital Notre-Dame.
Voilà. Merci beaucoup.
P. J.-R. : Merci à vous.